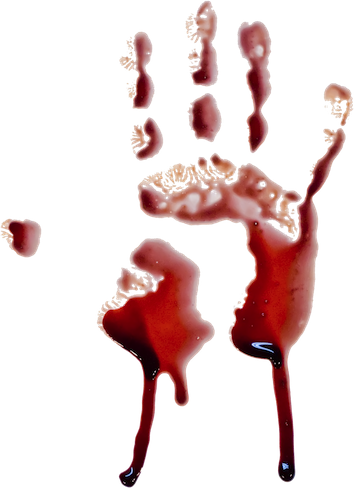Oh là là! Nous allons à Paris!
Cette année nous retournons a Paris.
Du 20 au 24 avril. les étudiants de français de 3º et 4º de ESO, nous partons á Paris faire notre voyage culturel.
Nous allons visiter la ville et ses principaux monuments, mais nous allons surtout partiquer la langue que nous apprenons depuis quelques années.
Pour préparer notre voyage nous faisons une étude de l´histoire et caractéristiques de tous les endroits à visiter et nous nous documentons sur internet.
Nous proposons un apperçu des plus importans monuments de Paris sur le site :
LES MONUMENTS DE PARIS
Nous proposons un apperçu des plus importans monuments de Paris sur le site :
LES MONUMENTS DE PARIS
Voilá ce que nous avons trouvé et trié et que nous proposons.
Un peu d´histoire des monuments
Paris
a pour origine un village de pécheurs celtes. La tribu des Parisii
s'installa au 3è siècle avant J.-C. dans l'île de la Cité, la
fortifia et l'appela Lutetia. En 52 av. J.-C.,
Lutèce tomba aux mains d'un lieutenant de Jules César. Les Romains
l'appelèrent la "ville des Parisii", Civitas Parisiorum.
La ville fut fortifiée et commença à s'étendre sur la rive gauche de
la Seine : c'est là que furent édifiés les thermes dits aujourd'hui
de Cluny
et les arènes
de Lutèce.
Le
christianisme fut introduit par saint Denis, premier évêque de la
ville, qui fut décapité par les Romains en 280. La légende rapporte
qu'il aurait alors marché avec sa tête jusqu'à l'emplacement de la
basilique de Saint-Denis. Menacés par les invasions barbares, les
Parisiens résistèrent en 451 aux Huns d'Attila sous l'inspiration de sainte
Geneviève qui devint la patronne de la ville.
En
486, Clovis s'empara sans combat de Paris et en fit la capitale du
royaume des Francs. Mais la ville fut délaissée par les derniers rois
Mérovingiens. Elle déclina surtout sous la dynastie des Carolingiens,
Charlemagne ayant choisi comme capitale Aix-la-Chapelle. Les habitants
abandonnèrent la rive gauche où ne restèrent que des établissements
religieux comme la puissante abbaye de Saint-Germain-des-Prés.
Au 9è siècle, les Normands ravagèrent à plusieurs reprises la
région de Paris : la cité fut soumise à un long siège viking en 885.
En
861 Paris était passée dans le patrimoine des Capétiens, qui
accédèrent au trône de France avec Hugues Capet en 987. Paris fut
d'abord la capitale d'un tout petit royaume, que les Capétiens
s'efforcèrent d'agrandir en s'imposant aux autres grands seigneurs. Aux
11è et 12è siècles, la ville connut une renaissance commerciale et
urbaine.
La
ville reprend alors son expansion sur les deux rives du fleuves,
notamment sur la rive droite. A la fin du 12è siècle, Philippe Auguste
crée des fontaines, fonde le marché
des Halles (à
l'origine de la fonction commerciale encore actuelle du quartier) et
fait paver les rues importantes. Pour protéger la ville, il fait
édifier (1180-1213) un puissant rempart renforcé par la forteresse du Louvre
(1204). Pendant plus de sept siècles (jusque 1919), Paris est restée
une ville fortifiée, ce qui explique sa forme circulaire (les
boulevards concentriques ayant remplacé les murailles successives), la
densité de l'occupation du sol, la rareté des espaces libres et des
jardins.
L'importance
du ravitaillement par voie fluviale donnait un pouvoir important à la
"guilde des marchands de l'eau" qui reçut du roi, en 1170 le
monopole de tout le trafic fluvial entre Mantes et Corbeil. Leur conseil
dirigeant, bientôt représenté par le prévôt des marchands,
s'installa au 14è siècle dans la maison aux Piliers, ancêtre de l'Hôtel
de Ville actuel.
Le roi, lui, était représenté par le prévôt de Paris résidant dans
la forteresse du Châtelet. Les deux autorités furent souvent rivales.
C'est
à cette époque que se crée la différenciation encore actuelle de
Paris : la ville médiévale se divise alors entre la rive droite
commerçante (avec le marché des Halles), la Cité siège du pouvoir
politique et religieux (encore aujourd'hui avec le Palais
de Justice et
l'hôpital de l'Hôtel-Dieu), et la rive gauche universitaire et
intellectuelle. En effet l'île de la Cité est alors parée de la
cathédrale Notre-Dame
(entreprise en 1163), de la Sainte-Chapelle
sous saint Louis (1246), tandis que le palais royal de la Cité est
agrandi par Philippe le Bel (1285-1314).
La
tradition intellectuelle de la rive
gauche date de
l'installation au 12è siècle de maîtres dissidents de la Cité : en
effet les contraintes imposées par le chancelier de Notre-Dame, qui
surveillait l'enseignement incitèrent certains maîtres à s'installer
hors de portée de son autorité, et à enseigner dans les granges de la
montagne Sainte-Geneviève. A partir de 1250, une soixantaine de
collèges abritent 700 "escholiers" et leur assurent gîte,
couvert et "répétitions". Le plus célèbre est celui fondé
en 1257 par Robert de Sorbon,
qui fut reconstruit au 19è siècle. L'université de Paris est alors
l'un des grands centres intellectuels (théologie, philosophie) de la
chrétienté médiévale. Avec 80 000 habitants,
Paris devient au 13è siècle la plus grande ville de l'Europe
chrétienne.
Mais
le 14è siècle ouvre des temps plus sombres : la population est
éprouvée par la famine de 1315-17 et par la peste de 1348-49. La
guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre fait de la capitale
un foyer d'agitation. En 1356, le prévôt des marchands Étienne Marcel
se rend maître de la ville contre le Dauphin français. Le roi Charles V
(1364-1380) construit une nouvelle enceinte rive droite afin de
protéger les nouveaux faubourgs contre les Anglais : la muraille est
renforcée par les forteresses de la Bastille
et du Louvre, qui est alors agrandie. Paris connaît par la suite de
nouveaux troubles. En 1420, la ville est occupée par les Anglais
auxquels elle se montre plutôt favorable. Vainement assiégée par
Jeanne d'Arc en 1429, Paris n'est reprise aux Anglais qu'en 1436 et
reste une ville un peu suspecte, qui ne retrouvera son rôle de capitale
que sous François Ier au siècle suivant.
La
paix et la prospérité reviennent dans la seconde moitié du 15è
siècle, dans un royaume à nouveau unifié. Les hôtels
de Sens et de Cluny
sont les dernières constructions de l'art gothique.
Le
16è siècle connaît un nouvel élan lorsque le Valois François Ier
revient résider dans la capitale après 1530, la cour restant
itinérante dans les châteaux royaux au gré des saisons. Il fait
abattre le vieux Louvre
pour le transformer en palais Renaissance, commence l'église Saint-Eustache
et l'Hôtel
de Ville. Ouverte
aux idées de la Renaissance, la ville connaît à nouveau un grand
rayonnement intellectuel et culturel
grâce à l'essor de
l'imprimerie, au travail de nombreux poètes et savants humanistes dont
les plus éminents enseignent au nouveau Collège
de France.
Mais
ardemment catholique, Paris est fondamentalement hostile à la Réforme
: les passions religieuses divisent la cité à partir de 1534 entre
catholiques et protestants. Le peuple massacre les huguenots à la
Saint-Barthélemy en 1572, se range dans le camp catholique de la Ligue,
se soulève à l'annonce de l'assassinat de son chef, le duc de Guise en
1588, et proclame la déchéance du roi Henri III. Henri IV n'entre à
Paris qu'après avoir abjuré sa foi protestante.
Elevant
au plus haut point la monarchie absolue et centralisatrice, les Bourbons
encouragent l'embellissement de la ville. Lors de son règne au
début du 17è siècle, Henri IV poursuit le Louvre
et le château des Tuileries commencé par Catherine de Médicis, ce qui
va favoriser l'extension des beaux quartiers vers l'ouest parisien. Le
monarque achève l'Hôtel de Ville et le Pont-Neuf,
fonde un nouveau type de places géométriques et homogènes avec la
place Royale (aujourd'hui place
des Vosges) et la
place
Dauphine. Le
rayonnement culturel de la capitale se renforce sous Louis XIII avec la
création de l'Imprimerie royale en 1620, du Jardin
des Plantes et de
l'Académie
française. Louis
XIII crée de nouvelles fortifications rive droite (actuels grands
boulevards) pour
permettre à la ville de s'agrandir : de nouveaux quartiers remplacent
la campagne dans le faubourg Saint-Honoré, l'île
Saint-Louis, le Marais,
le Faubourg Saint-Germain. Richelieu se fait construire le
Palais-Cardinal (aujourd'hui Palais-Royal),
Marie de Médicis déménage au palais du Luxembourg.
Pendant
la minorité de Louis XIV, Paris est affectée par les troubles de la
Fronde. En fait, le peuple parisien se retire rapidement de cette guerre
de grands seigneurs. Mais le Roi-Soleil n'oublia jamais qu'il avait dû
fuir, encore enfant, la capitale. Il bouda Paris et s'installa à
Saint-Germain, puis à Versailles en 1680. Avec ses 500 000
habitants, Paris resta cependant le centre de la vie intellectuelle et
ne cessa de s'embellir : Les constructions majestueuses se poursuivirent
sous l'autorité de Colbert, qui fit appel à de grands architectes
comme François Mansart et Claude Perrault. De la fin du 17è siècle
datent la colonnade du Louvre qui marqua l'avènement du style classique
par opposition au baroque italien, les Invalides,
l'Observatoire,
l'hôpital de la Salpêtrière,
le Collège des Quatre-Nation (aujourd'hui l'Institut),
les Portes Saint-Denis
et Saint-Martin,
les places royales Louis-le-Grand (Vendôme)
et des Victoires,
les jardins des Tuileries,
la manufacture des Gobelins.
Cette opulence architecturale contrastait fortement avec le Paris
populaire surpeuplé et misérable.
Le
siège du gouvernement resta à Versailles jusqu'à la fin de l'Ancien
Régime. Cette distance contribua d'ailleurs à rendre la monarchie
étrangère aux évolutions de son peuple.
Au
18è siècle, Paris devient le foyer des idées philosophiques des
"lumières" : dans les salons, dans les premiers cafés (dont
le Procope), on discute avec passion d'égalité, de libertés et de
souveraineté nationale. De nouveaux édifices sont construits : l'Ecole
militaire, l'Odéon,
le futur Panthéon,
Saint-Sulpice.
Le pont Louis XVI (de la Concorde) conduit désormais à la place Louis
XV, la première place royale ouverte (place
de la Concorde)…
En 1785, les fermiers généraux chargés de percevoir l'octroi, péage
payé par les marchandises entrant dans Paris, font édifier par Ledoux
les rotondes de la nouvelle enceinte (place Stalingrad,
de la Nation).
Dépourvu de fonction défensive, ce "mur qui rend Paris
murmurant" devait délimiter Paris jusqu'à 1860. Les jardins du Palais-Royal,
réaménagés et ouverts au public, deviennent un lieu de discussion et
d'effervescence, notamment le 12 juillet 1789.
La
Révolution française replaça d'un coup Paris à la tête de la
France. La capitale fut le théâtre de la plupart des événements
révolutionnaires et la victoire des Jacobins sur les Girondins accentua
le mouvement de centralisation. Anecdotique mais révélatrice, la
cocarde tricolore fut constituée des couleurs de la Ville de Paris, le
bleu et le rouge, entrelacées du blanc monarchique. "Mais puisque
Paris prétendait ainsi se substituer au reste du pays, et représenter
seul la nation tout entière, les Parisiens ne pouvaient plus prétendre
à jouir de la même autonomie que les habitants des autres villes. Ils
s'étaient liés au pouvoir central, pour le meilleur et pour le
pire". Napoléon en tira les conséquences en soumettant Paris à
un statut spécial, sans maire ni conseil municipal, "sous la
tutelle d'un préfet de la Seine et d'un préfet de police directement
aux ordres du gouvernement" (Michel Mourre). La centralisation
allait se poursuivre au 19è siècle et s'accentuer avec les
révolutions industrielles, l'exode rural, la création des réseaux de
communication ferroviaires puis routiers.
Napoléon
n'eut pas le temps de réaliser tous ses projets de grandeur pour la
capitale : il commença l'Arc
de Triomphe, la Bourse,
la colonne Vendôme,
les canaux de l'Ourcq,
Saint-Martin
et Saint-Denis. Il fit détruire les vieilles maisons des ponts et les
rives de la Seine pour retrouver la vue sur le fleuve.
A
la suite des guerres napoléoniennes, Paris fut occupée en 1814 et
1815, ce qui ne lui était plus arrivé depuis quatre siècles. Aussi
les Parisiens accueillirent avec soulagement le retour des Bourbons. La
ville entama une période de fort accroissement : elle passa de
600 000 habitants en 1800 à un million dès 1846, uniquement en
raison de l'afflux des provinciaux. L'accroissement démographique de la
France au 19è siècle fut presque entièrement absorbé par la
capitale. Mais les structures de la ville sont encore celles du Moyen
Âge et Paris devient une ville surpeuplée et insalubre. Certes l'ouest
reste résidentiel, mais à l'est de la ville, le petit peuple est
sous-alimenté, vulnérable aux épidémies (choléra en 1832) et la
mortalité reste assez forte. Cependant cette coupure sociologique ne se
traduit pas encore par un antagonisme politique : les révolutions de
1830 et de février 1848 voient l'alliance des ouvriers et de la
bourgeoisie parisienne contre la monarchie. La coupure se produit avec
l'insurrection socialiste de juin 1848 et la répression qu'elle
entraîne.
C'est
le second Empire qui transforma Paris et lui donna son visage actuel.
Influencé par la modernité qu'il avait vécue à Londres, souhaitant
à la fois améliorer la vie du peuple et assurer la rapidité de la
répression en cas d'émeute, Napoléon III confia à Georges Haussmann
la direction des travaux, de 1853 à 1869. Le préfet de la Seine devait
faire de Paris une grande capitale moderne, adaptée aux transports
modernes, assainie et aérée de parcs. Détruisant les vieux quartiers
centraux médiévaux, Haussmann créa des percées nord-sud et est-ouest
: ces grandes avenues rectilignes bordées d'arbres et d'immeubles
cossus en pierre de taille devaient relier visuellement les points forts
de la ville. Il fit aménager le train de Petite ceinture aujourd'hui
délaissé. Les ingénieurs Alphand et Belgrand aménagèrent un nouveau
réseau d'eau potable captant des sources d'eau en amont de la Seine, un
réseau d'égouts modernes, 2000 hectares de parcs et jardins, formant
un réseau hiérarchisé : depuis les deux grands bois de Boulogne
et de Vincennes
jusqu'aux petits squares aérant chaque quartier en passant par les
parcs des Buttes-Chaumont
et de Montsouris.
Le préfet créa de nouveaux équipements : des théâtres comme ceux de
la place du Châtelet,
l'opéra Garnier,
deux hôpitaux, des mairies etc. Napoléon III confia à Baltard le
réaménagement des Halles
centrales. Contrairement à Napoléon III qui finança la création de
plusieurs cités
ouvrières,
Haussmann ne se préoccupa pas de logement populaire.
Paris
atteignit alors les fortifications construites par Thiers en 1845.
Annexant en 1860 les communes périphériques comme Auteuil, les
Batignolles, la Villette,
Charonne,
Haussmann créa l'actuelle division administrative en 20 arrondissements
en prenant soin de diviser certaines communes trop remuantes telles Belleville.
Ces nouveaux quartiers encore ruraux s'urbanisèrent alors : ils furent
notamment habités par les ouvriers chassés des quartiers centraux par
l'augmentation des loyers.
Mais
l'Empire s'acheva piteusement en 1870 par la guerre franco-prussienne,
l'arrestation de l'Empereur, la proclamation de la République le 4
septembre 1870 et le siège de Paris. L'exaspération du siège et le
défilé allemand sur les Champs-Elysées provoqua l'insurrection de la
Commune, révolte
d'inspiration socialiste et ouvrière de mars à mai 1871. En butte au
nouveau gouvernement transféré à Versailles, les Communards
incendièrent de nombreux monuments, notamment l'hôtel de Ville et le
château des Tuileries.
La
fin du siècle est marquée par l'apaisement et l'installation d'une
IIIè République modérée. A partir de 1878, les grandes Expositions
universelles scandent les progrès scientifiques et techniques. Celle de
1889, dont le clou est la Tour
Eiffel marque
l'apogée de l'architecture de fer. L'Exposition universelle de 1900
lègue à la capitale le Grand
et le Petit
Palais ainsi que
la première ligne de métro décorée par Guimard.
En 1910 s'achève la construction de la basilique du Sacré-Coeur.
La ville connaît un nouveau foisonnement culturel et artistique
notamment avec les peintres impressionnistes, puis ceux de la Ruche
ou du Bateau-Lavoir
à Montmartre. Fascinés par l'extrême-orient, plusieurs passionnés
rassemblent des collections d'art asiatique qui constituent aujourd'hui
des musées (musées
d'Ennery, Cernuschi,
Guimet).
Le maximum de population est atteint en 1911, avec près de 2,9 millions
de Parisiens.
Lors
de la première guerre mondiale, Paris est préservée de l'invasion
allemande par la victoire de la Marne, à laquelle ont contribué les
taxis parisiens. En 1919, dans l'allégresse de la paix retrouvée, la
Ville démolit le mur d'enceinte de Thiers, d'ailleurs périmé avant
même la guerre de 1870. La vaste zone non-aedificandi est remplacée
par les boulevards des Maréchaux, la ceinture de HBM de briques roses
et beiges, et par la "ceinture verte" de Paris où s'élèvent
des équipements sportifs. Le "périphérique" ne sera
aménagé que dans les années 1960. Le Bois de Boulogne et de Vincennes
sont annexés et Paris trouve son allure actuelle.
Pendant
l'entre-deux-guerres, le rayonnement littéraire et artistique de Paris
dépasse de nouveau les frontières : les artistes de l'Europe entière
affluent à Montmartre et à Montparnasse. En matière de constructions,
c'est une période de transition : l'Etat bâtit dans le style imposant
et austère de l'époque (palais
de Chaillot, de
Tokyo), les
bourgeois apprécient les appartements en forme d'ateliers d'artiste (Bruno
Elkouken, Henri
Sauvage),
certains osent l'avant-garde moderniste (Auguste
Perret, Le
Corbusier, Mallet-Stevens).
Pendant
la deuxième guerre mondiale, Paris est occupé par la Wehrmacht en juin
1940. Malgré les difficultés d'approvisionnement, les arrestations de
juifs, les exécutions d'otages, la capitale poursuit sa vie littéraire
et théâtrale. Le 25 août 1945, von Choltitz signe la reddition des
forces allemandes à la gare Montparnasse.
Depuis
1945, l'évolution architecturale de Paris est la même que dans toutes
les villes françaises : des tours et des barres massives et monotones
dans les années 1950 et 1960, des immeubles modernes plus élaborés
dans les années 1970 (Unesco,
Maison
de la Radio…).
Les années 1980 ont marqué un retour aux gabarits classiques
"haussmanniens". L'alignement des immeubles sur la rue, la
diversité des formes furent affichés pour la première fois dans
l'ensemble des Hautes
Formes (13è
arrondissement). Cependant ce "après-modernisme" reste
fidèle aux volumes purs et cubiques de l'architecture moderne.
Dans
le même temps, de nombreux quartiers anciens furent
"rénovés". Suite à ces destructions-reconstructions du Front
de Seine, de Maine-Montparnasse,
des Halles,
les édiles ont pris conscience de la valeur des quartiers anciens :
Malraux a lancé les campagnes de ravalement dans le Marais,
premier "secteur sauvegardé" établi en 1962. A côté de ces
quartiers anciens en voie de muséification, la Mairie de Paris souhaite
aujourd'hui également préserver les quartiers à l'architecture plus
anodine, mais à la vie sociale active, comme le quartier de Montorgueil
ou le faubourg
Saint-Antoine.
Suite
à la normalisation de son statut en 1977, Paris a élu Jacques Chirac
comme premier maire depuis la Révolution. Depuis 1982, le statut
politique de Paris a de nouveau changé : la capitale a été divisée
en 20 mairies d'arrondissement : les électeurs choisissent 350
conseillers d'arrondissement qui élisent les maires d'arrondissement et
613 conseillers municipaux qui élisent le maire de Paris.
Héritiers
des monarques absolus, les présidents de la Vè République ont
également laissé leur empreinte dans le paysage urbain de la capitale
: après les ambitions de de Gaulle pour la région (aéroport de
Roissy), le président Pompidou
a créé le centre culturel qui porte son nom, malgré son désaccord
avec le projet architectural. La destruction des halles de Baltard et
les protestations qui s'ensuivirent ont suscité un intérêt croissant
pour le patrimoine du 19è : Valéry Giscard d'Estaing a choisi le
projet du musée
d'Orsay pour
occuper l'ancienne gare d'Orsay. Il a aussi opté pour la reconversion
des abattoirs de la Villette en Cité
des sciences. Ces
15 dernières années ont été marquées par le programme des grands
travaux de François Mitterrand. Il a inscrit dans Paris des bâtiments
imposants souvent inspirés de formes géométriques pures : l'Arche
de la Défense, la pyramide du Louvre,
l'opéra
Bastille, la
"Très
grande bibliothèque",
le Ministère
de l'Economie et
des finances de Bercy…
Ces
monuments font de la capitale une destination touristique choisie chaque
année par plus de 20 millions de visiteurs, tandis que la population
parisienne ne cesse de décroître, dépassant désormais de peu les 2
millions d'habitants. Paris est ainsi devenue une magnifique
ville-musée, un délicieux cadre festif pour les sorties et les
spectacles, un centre d'affaires cosmopolite et animé. Les habitants se
concentrent dans les arrondissements périphériques mieux aérés de
parcs (Citroën,
Belleville,
Bercy)
et d'équipements récents (stade Charlety,
hôpital Robert
Debré). Mais un
enfant sur deux a quitté la capitale d'un recensement à l'autre…
LA TOUR EIFFEL
La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889 qui célébrait le premier centenaire de la Révolution française. Sa construction en 2 ans, 2 mois et 5 jours, fût une véritable performance technique et architecturale.
« Utopie réalisée », prouesse technologique, elle fut à la fin du 19ème
siècle la démonstration du génie français incarné par Gustave Eiffel,
un point d’orgue de l’ère industrielle. Elle connut immédiatement un
immense succès.
Destinée à durer seulement 20 ans, elle fut sauvée par les expériences scientifiques
qu’Eiffel favorisa et en particulier les premières transmissions
radiographiques, puis de télécommunication : signaux radio de la Tour au
Panthéon en 1898, poste radio militaire en 1903, première émission de
radio publique en 1925, puis la télévision jusqu’à la TNT plus
récemment.
Depuis les années 80, le monument a régulièrement été rénové, restauré et aménagé pour un public toujours plus nombreux.
Au fil des décennies, la tour Eiffel a connu des exploits, des illuminations extraordinaires, des visiteurs prestigieux. Site mythique, audacieux, elle a toujours inspiré les artistes, les défis.
Elle est le théâtre de nombreux évènements de portée internationale
(mises en lumière, centenaire de la Tour, spectacle pyrotechnique de
l’an 2000, campagnes de peinture, scintillement, Tour bleue pour la
Présidence française de l’union européenne ou multicolore pour ses 120
ans, installations insolites comme une patinoire, un jardin…).
Universelle, tour de Babel, près de 250 millions de
visiteurs sans distinction d’âge ou d’origine sont venus de tous les
coins de la planète la découvrir depuis son ouverture en 1889.
Comme toutes les tours, elle permet de voir et d‘être
vue : ascension spectaculaire, panorama unique sur Paris, signe
rayonnant dans le ciel de la Capitale.
La Tour, c’est aussi la magie de la lumière. Son éclairage, son scintillement et son phare rayonnent et renouvellent le rêve tous les soirs.
Symbole de la France dans le monde, vitrine de Paris, elle accueille aujourd’hui près de 7 millions de visiteurs par an (dont environ 75% d’étrangers), ce qui en fait le monument payant le plus visité au monde.
Chaque campagne est l’occasion de vérifier l’état de la structure en
détail et de remplacer le cas échéant des petites pièces métalliques
corrodées.
La peinture appliquée en 2002 et 2009 est une formule sans pigments de plomb, remplacés par du phosphate de zinc comme agent anticorrosion, et plus résistante à la pollution atmosphérique.
De plus, des tests de peinture aux composés organiques volatiles et quasi dépourvue de solvant ont été effectués lors de la campagne 2009 en vue de répondre aux normes environnementales mondiales qui seront imposées après 2012.
 ANECDOTES SUR LA TOUR EIFFEL
ANECDOTES SUR LA TOUR EIFFEL
Photographe: Charles Marville
À l’origine, les Champs-Élysées ne sont que des terrains marécageux et inhabités. C’est en 1616 que Marie de Médicis décide d’y faire aménager, le long de la Seine, une longue allée bordée d’arbres: les jardins des Champs-Élysées. Ils bordent l’avenue du même nom, considérée par beaucoup comme la plus belle avenue de la capitale.
Marie de Médicis créa le Cours-la-Reine, une large promenade plantée d’arbres, qui s’étendait du Palais des Tuileries à l’actuelle place de l’Alma. Lenôtre modifia de nouveau son tracé, en 1670 et il fut rebaptisé « Grand-Cours ».
La promenade ne cessa de s’agrandir, le marquis de Marigny, frère de Madame de Pompadour, prolongeant l’avenue jusqu’au pont de Neuilly. A l’époque, les jardins de Champs-Elysées étaient devenus le lieu de promenade favori des militaires et des filles de joie. Les vaches y paissaient encore tranquillement, mais mieux valait-t-il être armé dès la nuit tombée… nombre de viols et de crimes étaient commis régulièrement…Elle s’appelait alors l’avenue de Neuilly.
Au début du 18e siècle, on redonna ses lettres de noblesse au jardin en le rebaptisant du nom du lieu de séjour des âmes vertueuses dans la mythologie grecque : les « Champs-Elysées ». L’avenue des Champs-Elysées se para alors d’une multitude d’hôtels particuliers et de grands hôtels de voyageurs et devint le lieu de promenade favori des élégantes.
Les Champs-Élysées virent défiler de nombreuses têtes couronnées qui privilégiaient cet axe grandiose pour leurs parades. C’est par là que l’impératrice Marie-Louise fit son entrée dans Paris, en 1810, et que les cendres de Napoléon passèrent devant une foule de 100 000 spectateurs, en 1840. Plus tard, le petit Marcel Proust y aura également ses habitudes, y faisant des promenades qu’il immortalisera un jour dans « A la recherche du temps perdu ».
En 1828, les jardins des Champs-Élysées devinrent la propriété de la Ville de Paris. S’inspirant des jardins à l’anglaise, l’ingénieur Alphand leur donna 12 ans plus tard l’aspect qu’on leur connaît aujourd’hui.
Parmi les hauts lieux qui s’y trouvent, notons le Grand Palais au sud, ainsi que le théâtre du Rond-Point et le théâtre Marigny. Les jardins du palais de l’Élysée jouxtent l’espace vert, au nord.
L’avenue a inspiré la création du Paseo de la Reforma à Mexico (Mexique) en 1860, de la Avenida 9 de julio à Buenos Aires, de la Benjamin Franklin Parkway à Philadelphie (Pennsylvanie) en1917 et du Corso Sempione à Milan.
LE SACRÉ COEUR

Depuis la nuit des temps, Montmartre a été un
lieu de culte : les Druides gaulois, les Romains avec les temples dédiés
à Mars et Mercure, l’Église Saint-Pierre, la plus ancienne de Paris,
reconstruite près de l’Abbaye Royale de Montmartre au XIIè siècle par le roi Louis VI et sa femme Adélaïde de Savoie… Enfin, le Sacré-Cœur, érigé à la fin du XIXè siècle. Aujourd’hui, ce haut-lieu de prière demeure fidèle à sa tradition : Dieu y est bien présent !
La chapelle primitive construite sur la Butte en l’honneur de saint Denis tombait en ruine au IXe siècle. Elle fut reconstruite à cette époque, la colline de Montmartre étant un lieu de pèlerinage extrêmement fréquenté. Outre saint Denis, on y vénérait les ossements d’un grand nombre de chrétiens anonymes martyrisés au cours des persécutions et qui ont contribué à faire appeler la colline : « mont des Martyrs » (Montmartre).
En 1559, un incendie détruisit une grande partie de l’abbaye des Bénédictines de Montmartre qui se trouvait au sommet de la Butte et, depuis lors, le mal alla s’aggravant jusqu’en 1611, époque où Marie de Beauvilliers qui, pendant près de soixante ans, gouverna l’abbaye, entreprit la restauration du Martyrium qui se trouvait au flanc de la colline. Autour de cette chapelle fut construit une nouvelle abbaye dite « d’en bas » reliée à celle d’en haut par une galerie longue et voûtée.
Au cours des travaux, le 11 juillet 1611, on mit à jour un escalier conduisant à l’ancienne crypte, sanctifiée, disait-on par saint Denis. Cette découverte fit grand bruit. Marie de Médicis et plus de soixante mille personnes se rendirent sur les lieux, créant un nouveau courant de dévotion.
A la fin du XIVe siècle, le roi de France Charles VI, après la guérison momentanée d’un premier accès de folie et après avoir échappé par miracle aux flammes d’un incendie, accomplit un pèlerinage d’action de grâces au Martyrium de Montmartre.
Au début du XVe siècle, dans Paris en proie à la lutte des Armagnacs et des Bourguignons, les scènes d’égorgements et de pillage furent telles que les paroisses parisiennes se rendirent en procession sur la colline de Montmartre pour demander à saint Denis de sauver la capitale.
En 1525, quand François Ier eut été fait prisonnier à la bataille de Pavie, le peuple de Paris en foule vint à Montmartre prier le patron du royaume pour que cesse la grande désolation.
Le 15 août 1534, c’est à Montmartre que saint Ignace, saint François-Xavier et leurs compagnons fondèrent, en quelque sorte, la Compagnie de Jésus.



1878 : Début des travaux de la crypte.
1881 : Début des travaux de la Basilique proprement dite.
1914 : Tout est prêt pour la consécration - y compris le clocher qui abrite « la Savoyarde », cloche de 19 tonnes - mais la première guerre mondiale éclate (1914 - 1918).
1919 : C’est le 16 octobre que la consécration aura lieu.
La grande mosaïque a été fabriquée de 1900 à 1922.
Les vitraux, posés de 1903 à 1920, mais détruits en 1944 par des bombardements, sont refaits en 1946.
Le grand orgue est signé Cavaillé-Coll.
Dôme : Hauteur 83 mètres
Coupole : hauteur 55 mètres, diamètre 16 mètres.
Du parvis de la Basilique, on voit toute la ville de Paris. La visite du Dôme, qui s’élève à plus de 200 mètres, permet d’apprécier un paysage qui s’étend à 50 km à la ronde. C’est donc le point le plus élevé de Paris après la Tour Eiffel (elle-même construite en 1889 !)
A sa consécration l’Eglise reçoit le titre de Basilique, c’est-à-dire qu’elle est un lieu de pèlerinage.
Le Cœur du Christ y est adoré dans le mystère de l’Eucharistie (Messe). La prière d’adoration est à la fois préparation et prolongement du mystère eucharistique.
Cette prière s’élève jour et nuit vers Dieu, prière de demande et d’intercession pour l’Eglise et le monde.

Promenade insolite sur les traces de la Basilique du Sacré-Coeur à Paris, en France et dans le monde...
Avec plus de 11 millions et demi de visiteurs par an,
la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre est le deuxième lieu le plus
visité de Paris (après la Cathédrale Notre-Dame), Paris étant elle-même
la ville la plus touristique du monde...Plus d’une centaine de milliers d’églises et sanctuaires de par le monde sont affiliés à la Basilique du Sacré-Coeur,
et demeurent en communion de prière avec l’adoration eucharistique
continue de jour et de nuit, qui rayonne depuis Montmartre sur le monde
entier.

La mosaïque du Christ en gloire Inaugurée en
1923, la mosaïque du chœur d’Olivier Merson, H. M. Magne et R. Martin,
avec ses 475 m2, est une des plus
grandes mosaïques du monde. Elle représente le Christ ressuscité, vêtu
de blanc, les bras grands ouverts, laissant voir un cœur d’or.

A peine un peu plus haut que le dôme de la
Basilique et au nord de celui-ci s’élève le campanile, également de
style romano-byzantin, avec au sommet un chemin de ronde, un cône et un
lanternon. Haut de 84 mètres, il est l’œuvre de Lucien Magne qui a pris
la direction des travaux de construction de la Basilique après le décès,
en 1884, de l’architecte Paul Abadie.
Les cloches de la Basilique
Il abrite la célèbre Savoyarde (cf. ci a-côté), dont le vrai nom est « Françoise Marguerite ». C’est la plus grosse cloche du monde, du moins parmi celles qui peuvent se balancer. Elle pèse 19 tonnes. Sa tonalité, celle du contre-ut grave, est très caractéristique. Elle a été offerte par les 4 diocèses de Savoie et fondue en 1895 à Annecy par l’entreprise Paccard, dont la renommée date de cette époque. « Les Paccard ont retrouvé les vieux secrets des fondeurs flamands du Moyen-Age pour accorder l’harmonisation interne des cloches ». Tirée par 28 chevaux, elle arriva dans la nuit du 16 octobre 1895 le jour de la Sainte Marguerite Marie. Elle a été transportée à grand peine sur la hauteur.
Depuis 1969, elle a été rejointe par quatre autres cloches : Félicité, Louise, Nicole et Elisabeth, qui proviennent de l’église Saint-Roch, vouée au silence par sa situation, et qui datent de la Restauration. Elles sonnent do, ré, mi, sol et font avec la Savoyarde un beau carillon
Objet de discorde, de convoitise et de fascination, la
tour Eiffel ne laisse personne indifférent. Riche d’une histoire pleine
de rebondissements, elle vous révèle ici toutes ses informations clés.
Découvrez tous les chiffres clés de la tour Eiffel grâce à cette infographie !
(cliquez sur l'image pour accéder à l'infographie complète).
(cliquez sur l'image pour accéder à l'infographie complète).
La peinture de la tour Eiffel
La campagne de peinture est un événement important de la
vie du monument et revêt, comme tout ce qui est lié à la tour Eiffel, un
caractère véritablement mythique : pérennité d'un ouvrage d'art connu
dans le monde entier, couleur du monument symbole du paysage parisien,
prouesse technique des peintres insensibles au vertige, importance des
moyens mis en œuvre.
La tour Eiffel en chiffres
Découvrez tous les chiffres clés de la tour Eiffel grâce à cette infographie !
(cliquez sur l'image pour accéder à l'infographie complète).
(cliquez sur l'image pour accéder à l'infographie complète).
La protection de la Tour
Construite en fer puddlé, la Tour est protégée de l'oxydation par plusieurs couches de peinture, gage de sa pérennité.
La Tour a été repeinte dix-neuf fois depuis sa
construction, soit une fois en moyenne tous les sept ans. Elle arbore
depuis 1968 le « brun tour Eiffel », semblable au bronze, une couleur
spécialement conçue pour elle et réservée à son seul usage. Elle se
décline en trois tonalités, de la plus claire au sommet à la plus foncée
en bas, pour assurer une perception uniforme de la teinte dans le ciel
de Paris, qui donne au monument son aspect élancé dans le ciel. Mais la
Tour a changé plusieurs fois de couleur, passant du rouge-brun, dans les
années 50, à l'ocre jaune en 1899.
QUELQUES CHIFFRES pour une campagne de peinture :
- 250 000 m2 de surface à peindre ;
- 25 peintres tous spécialistes de travaux sur charpente métallique en hauteur et sur pylônes, parfaitement insensibles au vertige ;
- 60 tonnes de peinture ;
- on estime à 15 tonnes environ le poids de peinture érodée entre deux campagnes ;
- 50 kilomètres de lignes de vie (cordes de sécurité) ;
- 2 hectares de filets de protection ;
- 1 500 brosses ;
- 1 500 combinaisons de travail ;
- 5 000 disques abrasifs ;
- 1 000 « riflards » (spatules à gratter) ;
- 1 000 paires de gants en cuir ;
- budget : environ 4 millions d’euros :
- durée : environ 18 mois, sans que jamais le monument ne ferme au public
L’occasion d’un check-up complet et de tests de peinture encore plus respectueuses de l’environnement
Chaque campagne est l’occasion de vérifier l’état de la structure en
détail et de remplacer le cas échéant des petites pièces métalliques
corrodées.La peinture appliquée en 2002 et 2009 est une formule sans pigments de plomb, remplacés par du phosphate de zinc comme agent anticorrosion, et plus résistante à la pollution atmosphérique.
De plus, des tests de peinture aux composés organiques volatiles et quasi dépourvue de solvant ont été effectués lors de la campagne 2009 en vue de répondre aux normes environnementales mondiales qui seront imposées après 2012.

LES CHAMPS ÉLYSÉES
12
août
Année: 1868 Photographe: Charles Marville
À l’origine, les Champs-Élysées ne sont que des terrains marécageux et inhabités. C’est en 1616 que Marie de Médicis décide d’y faire aménager, le long de la Seine, une longue allée bordée d’arbres: les jardins des Champs-Élysées. Ils bordent l’avenue du même nom, considérée par beaucoup comme la plus belle avenue de la capitale.
Marie de Médicis créa le Cours-la-Reine, une large promenade plantée d’arbres, qui s’étendait du Palais des Tuileries à l’actuelle place de l’Alma. Lenôtre modifia de nouveau son tracé, en 1670 et il fut rebaptisé « Grand-Cours ».
La promenade ne cessa de s’agrandir, le marquis de Marigny, frère de Madame de Pompadour, prolongeant l’avenue jusqu’au pont de Neuilly. A l’époque, les jardins de Champs-Elysées étaient devenus le lieu de promenade favori des militaires et des filles de joie. Les vaches y paissaient encore tranquillement, mais mieux valait-t-il être armé dès la nuit tombée… nombre de viols et de crimes étaient commis régulièrement…Elle s’appelait alors l’avenue de Neuilly.
Au début du 18e siècle, on redonna ses lettres de noblesse au jardin en le rebaptisant du nom du lieu de séjour des âmes vertueuses dans la mythologie grecque : les « Champs-Elysées ». L’avenue des Champs-Elysées se para alors d’une multitude d’hôtels particuliers et de grands hôtels de voyageurs et devint le lieu de promenade favori des élégantes.
Les Champs-Élysées virent défiler de nombreuses têtes couronnées qui privilégiaient cet axe grandiose pour leurs parades. C’est par là que l’impératrice Marie-Louise fit son entrée dans Paris, en 1810, et que les cendres de Napoléon passèrent devant une foule de 100 000 spectateurs, en 1840. Plus tard, le petit Marcel Proust y aura également ses habitudes, y faisant des promenades qu’il immortalisera un jour dans « A la recherche du temps perdu ».
En 1828, les jardins des Champs-Élysées devinrent la propriété de la Ville de Paris. S’inspirant des jardins à l’anglaise, l’ingénieur Alphand leur donna 12 ans plus tard l’aspect qu’on leur connaît aujourd’hui.
Parmi les hauts lieux qui s’y trouvent, notons le Grand Palais au sud, ainsi que le théâtre du Rond-Point et le théâtre Marigny. Les jardins du palais de l’Élysée jouxtent l’espace vert, au nord.
L’avenue a inspiré la création du Paseo de la Reforma à Mexico (Mexique) en 1860, de la Avenida 9 de julio à Buenos Aires, de la Benjamin Franklin Parkway à Philadelphie (Pennsylvanie) en1917 et du Corso Sempione à Milan.
LE SACRÉ COEUR
Histoire

- Photo : diocèse de Paris
Montmartre, le « Mont des martyrs »
Par sainte Geneviève, qui vivait au Ve siècle, nous connaissons l’existence de saint Denis. C’est par elle que ce premier évêque de Paris entre dans l’histoire ; car il est raconté dans la vie de cette sainte écrite par un de ses contemporains que, vers 475, elle décida le peuple parisien à élever une chapelle sur le lieu où il fut martyrisé. Saint Denis, premier évêque et martyr de Paris, ainsi que sa légende, illustrent cette période où les disciples du Christ triomphèrent « non en combattant, mais en mourant ».La chapelle primitive construite sur la Butte en l’honneur de saint Denis tombait en ruine au IXe siècle. Elle fut reconstruite à cette époque, la colline de Montmartre étant un lieu de pèlerinage extrêmement fréquenté. Outre saint Denis, on y vénérait les ossements d’un grand nombre de chrétiens anonymes martyrisés au cours des persécutions et qui ont contribué à faire appeler la colline : « mont des Martyrs » (Montmartre).
En 1559, un incendie détruisit une grande partie de l’abbaye des Bénédictines de Montmartre qui se trouvait au sommet de la Butte et, depuis lors, le mal alla s’aggravant jusqu’en 1611, époque où Marie de Beauvilliers qui, pendant près de soixante ans, gouverna l’abbaye, entreprit la restauration du Martyrium qui se trouvait au flanc de la colline. Autour de cette chapelle fut construit une nouvelle abbaye dite « d’en bas » reliée à celle d’en haut par une galerie longue et voûtée.
Au cours des travaux, le 11 juillet 1611, on mit à jour un escalier conduisant à l’ancienne crypte, sanctifiée, disait-on par saint Denis. Cette découverte fit grand bruit. Marie de Médicis et plus de soixante mille personnes se rendirent sur les lieux, créant un nouveau courant de dévotion.
A la fin du XIVe siècle, le roi de France Charles VI, après la guérison momentanée d’un premier accès de folie et après avoir échappé par miracle aux flammes d’un incendie, accomplit un pèlerinage d’action de grâces au Martyrium de Montmartre.
Au début du XVe siècle, dans Paris en proie à la lutte des Armagnacs et des Bourguignons, les scènes d’égorgements et de pillage furent telles que les paroisses parisiennes se rendirent en procession sur la colline de Montmartre pour demander à saint Denis de sauver la capitale.
En 1525, quand François Ier eut été fait prisonnier à la bataille de Pavie, le peuple de Paris en foule vint à Montmartre prier le patron du royaume pour que cesse la grande désolation.
Le 15 août 1534, c’est à Montmartre que saint Ignace, saint François-Xavier et leurs compagnons fondèrent, en quelque sorte, la Compagnie de Jésus.
Architecture


La construction :
L’architecte est Paul ABADIE, mais six architectes se succédèrent pour achever l’édifice.Le style : Romano-byzantin
En contraste avec les églises du Moyen- Age (par exemple le style gothique de Notre-Dame de Paris - 1163-1240), le style s’inspire de modèles comme Sainte Sophie de Constantinople ou encore San Marco de Venise ou Ravenne.
Les pierres
les pierres extérieures, appelées « Château-Landon », proviennent de la carrière de Souppes en Seine et Marne et ont la propriété particulière d’êtres très dures, d’avoir un grain très fin et de blanchir au contact de l’eau de pluie.La durée des travaux
1875 : Pose de la première pierre puis travaux, pendant plusieurs mois, de soutènement. Il faut creuser des puits de 33 mètres de profondeur, qui, comblés deviennent des piliers sur lesquels repose l’édifice. Sans ces piliers la Basilique s’enfoncerait dans la glaise.1878 : Début des travaux de la crypte.
1881 : Début des travaux de la Basilique proprement dite.
1914 : Tout est prêt pour la consécration - y compris le clocher qui abrite « la Savoyarde », cloche de 19 tonnes - mais la première guerre mondiale éclate (1914 - 1918).
1919 : C’est le 16 octobre que la consécration aura lieu.
L’intérieur
L’architecture intérieure, également de style romano-byzantin, concourt à donner à cette « Maison de Dieu » une atmosphère d’harmonie et de paix. La lumière et les détails architecturaux portent l’attention sur le chœur, lieu des célébrations liturgiques, lieu de l’Adoration du Saint-Sacrement.La grande mosaïque a été fabriquée de 1900 à 1922.
Les vitraux, posés de 1903 à 1920, mais détruits en 1944 par des bombardements, sont refaits en 1946.
Le grand orgue est signé Cavaillé-Coll.
- Le Chemin de Croix du déambulatoire :
- La Chapelle de la Vierge :
Les dimensions
Basilique : largeur : 85 mètres - longueur : 35 mètresDôme : Hauteur 83 mètres
Coupole : hauteur 55 mètres, diamètre 16 mètres.
Du parvis de la Basilique, on voit toute la ville de Paris. La visite du Dôme, qui s’élève à plus de 200 mètres, permet d’apprécier un paysage qui s’étend à 50 km à la ronde. C’est donc le point le plus élevé de Paris après la Tour Eiffel (elle-même construite en 1889 !)
A sa consécration l’Eglise reçoit le titre de Basilique, c’est-à-dire qu’elle est un lieu de pèlerinage.
Le Cœur du Christ y est adoré dans le mystère de l’Eucharistie (Messe). La prière d’adoration est à la fois préparation et prolongement du mystère eucharistique.
Cette prière s’élève jour et nuit vers Dieu, prière de demande et d’intercession pour l’Eglise et le monde.
La Basilique en France et dans le monde

La mosaïque du choeur

La Savoyarde

Il abrite la célèbre Savoyarde (cf. ci a-côté), dont le vrai nom est « Françoise Marguerite ». C’est la plus grosse cloche du monde, du moins parmi celles qui peuvent se balancer. Elle pèse 19 tonnes. Sa tonalité, celle du contre-ut grave, est très caractéristique. Elle a été offerte par les 4 diocèses de Savoie et fondue en 1895 à Annecy par l’entreprise Paccard, dont la renommée date de cette époque. « Les Paccard ont retrouvé les vieux secrets des fondeurs flamands du Moyen-Age pour accorder l’harmonisation interne des cloches ». Tirée par 28 chevaux, elle arriva dans la nuit du 16 octobre 1895 le jour de la Sainte Marguerite Marie. Elle a été transportée à grand peine sur la hauteur.
Depuis 1969, elle a été rejointe par quatre autres cloches : Félicité, Louise, Nicole et Elisabeth, qui proviennent de l’église Saint-Roch, vouée au silence par sa situation, et qui datent de la Restauration. Elles sonnent do, ré, mi, sol et font avec la Savoyarde un beau carillon
VISITE VIRTUELLE PANORAMIQUE.
 La Sorbonne doit son nom à son fondateur, Robert de Sorbon, Chapelain et confesseur du Roi de France Saint-Louis (Louis IX).
Son histoire, au cours des siècles, a été si intimement liée à
celle de l’Université de Paris, qu’elle en est devenue le symbole.
La Sorbonne doit son nom à son fondateur, Robert de Sorbon, Chapelain et confesseur du Roi de France Saint-Louis (Louis IX).
Son histoire, au cours des siècles, a été si intimement liée à
celle de l’Université de Paris, qu’elle en est devenue le symbole.
L’Université naît au XIIIème siècle de l’organisation en corporation des maîtres et écoliers de Paris. Primitivement installés dans l’Île de la Cité, ces derniers sont venus, dès le XIIème siècle, dans le futur « quartier Latin », rive gauche de la Seine, où la théologie, le droit, la médecine et les arts sont enseignés, en plein air, à des jeunes gens venant des 4 Nations (Française, Picarde, Normande et Anglaise), conférant ainsi à l’Université, dès l’origine, un prestige international.
Le collège de Robert de Sorbon, fondé en 1253, est alors un des nombreux collèges hébergeant sur le flanc de la montagne Sainte-Geneviève des étudiants pauvres.
Très vite, ces collèges deviennent le cadre des disciplines universitaires de Paris, et le Collège de Sorbon une célèbre Faculté de Théologie « LA SORBONNE » qui prendra une part active aux débats Philosophiques et Politiques de son temps, oscillant au grès d’une histoire foisonnante entre un conservatisme jaloux et un libéralisme éclairé.
Au XVIIème siècle, la Sorbonne est reconstruite par l’architecte Jacques Lemercier à la demande du Cardinal Duc de Richelieu, qui en devient le proviseur en 1622.
Fermée par la révolution en 1791, puis devenue atelier d’artistes en 1801, la Sorbonne est, sous la Restauration, à nouveau réaffectée à l’enseignement par le Roi Louis XVIII qui y fait aussi installer l’Académie de Paris et l’Ecole des Chartes en 1821.
A la fin de XIXe siècle, la troisième République la reconstruira à son tour pour faire de la Nouvelle Sorbonne le sanctuaire de l’Esprit, le lieu privilégié de la Connaissance.
video de la -sorbonne
video histoire de la Sorbonne

 Liens internet.
Liens internet.

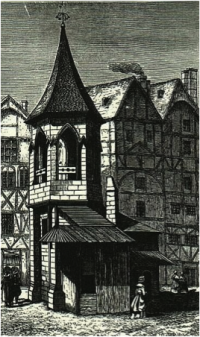

 L’atmosphère des Halles au 19e siècle nous est très bien rendue par Emile Zola, qui leur laissera le nom de Ventre de Paris (de son roman écrit en 1873).
L’atmosphère des Halles au 19e siècle nous est très bien rendue par Emile Zola, qui leur laissera le nom de Ventre de Paris (de son roman écrit en 1873).
 Après avoir ravitaillé Paris pendant plus de 800 ans, ces Halles sont
détruites en 1969 et le marché est transféré à Rungis et à la Villette
par manque de place. Cette opération qui a duré plus de 10 ans a été
considérée comme le « déménagement du siècle »: on surnommait le
chantier « le trou des halles ».
Après avoir ravitaillé Paris pendant plus de 800 ans, ces Halles sont
détruites en 1969 et le marché est transféré à Rungis et à la Villette
par manque de place. Cette opération qui a duré plus de 10 ans a été
considérée comme le « déménagement du siècle »: on surnommait le
chantier « le trou des halles ».
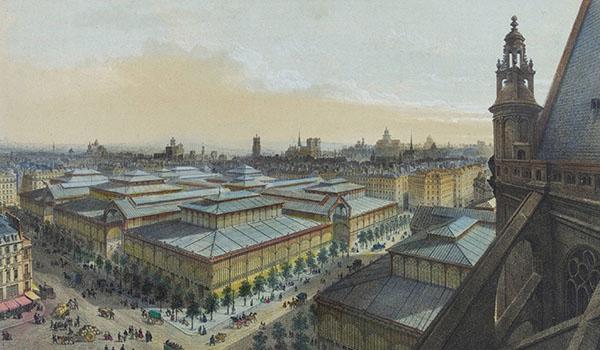


 Des pavillons de Baltard, il ne nous reste malheureusement que le
n°8, remonté à Nogent sur Marne, et qui accueille aujourd’hui des
émissions de télé et des spectacles.
Des pavillons de Baltard, il ne nous reste malheureusement que le
n°8, remonté à Nogent sur Marne, et qui accueille aujourd’hui des
émissions de télé et des spectacles.
 Le Forum des Halles tel qu’on l’a connu ces dernières années a été
inauguré en 1979, mais il n’aura tenu qu’une trentaine d’années puisque
les Halles sont aujourd’hui encore en travaux.
Le Forum des Halles tel qu’on l’a connu ces dernières années a été
inauguré en 1979, mais il n’aura tenu qu’une trentaine d’années puisque
les Halles sont aujourd’hui encore en travaux.
 Du Ventre de Paris, il nous reste malgré tout quelques institutions
installées dans les rues aux alentours comme l’Escargot Montorgueil
(1832) ou encore le Pied de cochon (1947), qui fut le premier
établissement parisien à pouvoir rester ouvert 7j/7, 24h/24, 365 jours
par an.
Du Ventre de Paris, il nous reste malgré tout quelques institutions
installées dans les rues aux alentours comme l’Escargot Montorgueil
(1832) ou encore le Pied de cochon (1947), qui fut le premier
établissement parisien à pouvoir rester ouvert 7j/7, 24h/24, 365 jours
par an.
LE LOUVRE









La plus grande place de Paris (259 mètres de côté), conçue en 1754 par l’architecte de Louis XV, Jacques-Ange Gabriel, s'appelait alors la Place Louis XV.
En 1793, la Place Louis XV devient la Place de la Révolution et installe en son centre la guillotine qui exécuta en particulier Louis XVI et Marie-Antoinette. En 1830, à l'issue de la Révolution de juillet, la place reçoit son nom définitif « La Concorde ». La Place conserve aujourd'hui l'aspect général qu'elle avait au dix-huitième siècle.
L'Obélisque de Louxor offert par le vice-roi d'Egypte, Mohamed Ali au roi Louis Philippe est installé en 1836. De granit rose, haut de 23 mètres, lourd de 230 tonnes, vieux de 33 siècles, il marquait auparavant l'entrée du temple d'Amon à Louxor. Son sommet est surmonté d'un pyramidion de bronze et de feuilles d'or ajouté en mai 1998.
Il est entouré de deux hautes fontaines dédiées à la navigation maritime et fluviale et bordé de statues qui représentent de grandes villes françaises : Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Brest et Rouen.
Cette place se situe sur le grand axe qui traverse Paris depuis l'ouest avec La Défense, l'Arc de triomphe, les Champs-Elysées, le jardin des Tuileries, le Louvre.
À l'entrée du Jardin des Tuileries, se trouve la statue d'André Le Nôtre, paysagiste français, jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 1700 qui a conçu l'aménagement du parc du palais de Versailles, de Vaux-le-Vicomte, de Chantilly…, et de nombreux autres jardins.
Les caractéristiques de ses travaux sont le schéma géométrique, les vastes perspectives, l'usage des plans et des jeux d'eaux, de statues qui créent un cadre imposant et font la célébrité du jardin "à la française".
Le Jardin à la Française, prolongement du château répond à l'architecture. Rien n'est laissé au hasard. Tout est fait pour que le visiteur ait une vision d'ensemble de l'agencement global du jardin.
Le plan d'ensemble est géométrique et la symétrie est poussée à l'extrême :
- division en espaces découverts (allée, pelouse, bosquet) et espaces couverts (plantés d'arbres)
- ordre le long d'un axe de symétrie qui traverse le jardin
- lignes droites des allées parallèles ou transversales qui se coupent.
- illusions perspectives : André Le Nôtre étudia avec minutie la peinture et les effets d'optiques afin de créer des jeux de perspective. Par exemple, il a décalé les petits bassins ronds des Jardins Réservés, situés à gauche et à droite du Bassin Rond (côté place du Carrousel), afin qu’ils paraissent plus vaste que le Bassin Octogonal alors qu'il est deux fois plus petit.


En 1806, le sommet de l'arc du Carrousel comportait initialement quatre sculptures de chevaux que Napoléon avait pris à la cathédrale Saint-Marc de Venise et qui seront rendus en 1815. Il comportait deux allégories, la Victoire et la Paix, et un char sur lequel devait se trouver une statue de l'empereur. Celui-ci ayant refusé d’être représenté, le char est resté vide. L'arc du Carrousel réutilise un vocabulaire décoratif antique : des colonnes corinthiennes de marbre blanc et rouge, des bas-reliefs retraçant les épisodes majeurs de la campagne, le quadrige (char de quatre chevaux) à son sommet. Ce style qui s'inspire de l'Antiquité est appelé « néoclassicisme ».

Le roi Philippe Auguste en 1190 ordonne la construction d'un mur d'enceinte qui protège Paris d'une éventuelle invasion des anglais qui sont basés en Normandie. Le château fort du Louvre, sur la rive droite de la Seine surveille l'accès à la ville. Le donjon entouré d'un fossé et de solides murailles, domine toute la ville et constitue le symbole du pouvoir monarchique.
Le roi Saint Louis fait aménager une grande salle et une salle basse en 1226 (dite salle Saint Louis visible encore aujourd’hui). En1285, Philippe Le Bel y place son arsenal, les archives et le trésor royal qui restera dans le donjon pendant quatre siècles. Le Louvre perd sa fonction défensive et est transformé par Charles V en 1364 en un château de plaisance. Le maitre d'œuvre, Raymond du Temple, perce des fenêtres, orne la façade de statues, élève les toitures, des tourelles et installe des cheminées. Charles V, qui est un roi lettré, installe sa bibliothèque de 973 livres, qui est la plus riche du royaume et fait planter un jardin d'agrément ainsi qu'un jardin potager au nord.

En 1981, le président de la République, François Mitterrand décide de transformer le Louvre afin d'agrandir le musée.Le projet d'aménagement de la cour est confiée à l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei.
Le ministère des Finances (installé au Louvre depuis un siècle) doit quitter l'aile Richelieu afin de laisser la place aux collections du musée. Le public, toujours plus nombreux, doit pouvoir circuler sans difficulté. L'entrée principale sera placée au centre du Louvre, dans la cour Napoléon, par commodité et par souci de clarté de l'orientation. Comment construire un tel aménagement ?
Trois solutions sont envisagées : construire à la manière des constructions environnantes en imitant les différents styles déjà présents ; construire en sous-sol et ne rien laisser visible en surface ; construire un bâtiment qui donne espace et lumière au nouveau hall d'accueil du musée. Cette dernière solution sera retenue et Ieoh Ming Pei proposera une pyramide, forme qui s'intègre parfaitement dans l'espace avec un volume moins imposant qu'une forme cubique ou rectangulaire.
La pyramide a les mêmes proportions que la pyramide de Gizeh. Chaque face de la pyramide est constituée de 128 poutres en acier inox, croisées, parallèles aux arêtes de la pyramide.
Le vitrage est constitué de 675 losanges de 2,9 m x 1,9 m. Ils sont constitués par deux couches de verre "extra blanc" de 10 mm d'épaisseur. Tour de force technologique, la fabrication de ce verre totalement incolore a nécessité la construction d'un four spécial fonctionnant à l'électricité pour diminuer les oxydes de fer. Grâce à cette transparence absolue, les pierres du palais environnant, vues de l'intérieur de la pyramide, gardent leur couleur miel.
La Pyramide est inaugurée le 30 mars 1989. Son coût est de 75 millions de francs (11.43 millions d'euros), la toiture la plus chère du monde. Le nettoyage assuré par des guides de haute montagne est maintenant assuré par un robot. La pyramide attire du monde : le Louvre est passé de trois millions de visiteurs annuels avant l’aménagement à 8,5 millions en 2008.

La plus ancienne prison de Paris résonne encore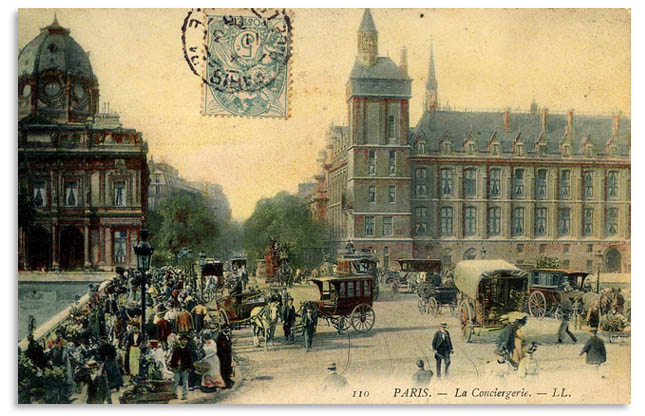 des sanglots de Maie-Antoinette, Reine de France
et femme de Louis XVI, attendant dans son cachot l'heure fatale de sa
décapitation durant cinq semaines. Non loin de la
Sainte-Chapelle, la Conciergerie fascine les visiteurs à cause
de ce souvenir sombre de la Révolution française. A cette
époque, plus de 4000 prisonniers furent mis à l'abri
derrière les murs froids et épais de cette prison-tribunal,
en attendant leur funeste rendez-vous avec la guillotine. Robespierre
et Danton eux-mêmes, grands ordonnateurs de peines capitales,
furent mis aux fers dans les lieux. La cellule de la reine
déchue demeure, de loin, l'attraction la plus prisée des
touristes. Pourtant, un autre détenu célèbre fut
emprisonné et torturé dans cette bâtisse :
Ravaillac, l'assassin du bon roi Henri IV. Autre curiosité de la
Conciergerie, la salle gothique des Gens d'Armes abritait les soldats
de la garde du roi. Remarquablement bien préservée,
elle évoque parfaitement la vie de caserne à
l'époque de sa construction par Phlippe le Bon au XIVème
siècle Ne pas oublier de visiter la salle de tortures
logée dans la Tour Bonbec pour éprouver un frisson. A
l'extérieur de la Conciergerie, sur le mur du Palais de Justice,
angle du quai de l'Horloge, se trouve encore la première horloge
publique parisienne, fabriquée en 1370 et en parfait état
de marche.
des sanglots de Maie-Antoinette, Reine de France
et femme de Louis XVI, attendant dans son cachot l'heure fatale de sa
décapitation durant cinq semaines. Non loin de la
Sainte-Chapelle, la Conciergerie fascine les visiteurs à cause
de ce souvenir sombre de la Révolution française. A cette
époque, plus de 4000 prisonniers furent mis à l'abri
derrière les murs froids et épais de cette prison-tribunal,
en attendant leur funeste rendez-vous avec la guillotine. Robespierre
et Danton eux-mêmes, grands ordonnateurs de peines capitales,
furent mis aux fers dans les lieux. La cellule de la reine
déchue demeure, de loin, l'attraction la plus prisée des
touristes. Pourtant, un autre détenu célèbre fut
emprisonné et torturé dans cette bâtisse :
Ravaillac, l'assassin du bon roi Henri IV. Autre curiosité de la
Conciergerie, la salle gothique des Gens d'Armes abritait les soldats
de la garde du roi. Remarquablement bien préservée,
elle évoque parfaitement la vie de caserne à
l'époque de sa construction par Phlippe le Bon au XIVème
siècle Ne pas oublier de visiter la salle de tortures
logée dans la Tour Bonbec pour éprouver un frisson. A
l'extérieur de la Conciergerie, sur le mur du Palais de Justice,
angle du quai de l'Horloge, se trouve encore la première horloge
publique parisienne, fabriquée en 1370 et en parfait état
de marche.
LA SAINTE CHAPELLE


LA CATHÉDRALE DE NOTRE DAME

VUES PANORAMIQUES DE LA TERRASE


Situé au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, le Centre Pompidou
dévoile son architecture unique, intemporelle et résolument moderne,
offrant aux yeux du visiteur la plus belle vue sur la capitale. Depuis
les niveaux supérieurs le regard embrasse la ville lumière et ses
monuments les plus emblématiques comme Notre Dame, la Tour Eiffel ou le
Sacré Cœur. Derrière son maillage de tuyaux colorés, le bâtiment
déploie, sur 6 niveaux, de nombreux espaces entièrement dédiés à la
culture et à l’art parmi lesquels la plus grande collection d’art
moderne et contemporain en Europe. Riche de près de 100 000 œuvres, il
abrite les chefs d’œuvre des maîtres de l’art moderne - Picasso,
Kandinsky, Matisse, Chagall ; Léger, Miro, Dali, Dubuffet, Klein… - et
des artistes majeurs de la scène contemporaine - Buren, Boltanski,
Opalka, Twombly, Hantaï, Tallon, Widmer, Garouste…
Le Centre Pompidou accueille, chaque année, près de 25 expositions temporaires qui font événement avec la mise en lumière des figures magistrales et mouvements fondateurs de l’histoire de l’art du XXème siècle ainsi que les plus grands artistes de la scène contemporaine. Une riche programmation de cinéma, de théâtre, de danse, de concerts, de conférences et de colloques, des espaces pour le jeune public, une bibliothèque publique d’information, des boutiques et restaurants, complètent ce foisonnement artistique et font du Centre Pompidou un lieu pluridisciplinaire unique au monde.
Le quartier Montmartre
Origine du nom

- Sanctum Martyrium
L’étymologie du nom Montmartre est un
peu floue, certains historiens le font dériver du Mons Mercurei et Mons
Martis, le Mont de Mercure et de Mars : des vestiges de temples
gallo-romains dédiés à ces divinités ont été découverts.
D’autres du Mons Martyrium, le mont des Martyrs, à cause de la légende du martyre de Saint Denis et de ses compagnons : Rustique et Eleuthère conté par l’Abbé Hilduin qui souhaitait éclipser les cultes païens.
En 475 Sainte Geneviève fit transporter
le cercueil de Saint Denis dans un oratoire au col de la Chapelle (
emplacement actuel de l’Eglise Saint Denys de la Chapelle ), puis le roi
Dagobert le fit transférer à l’abbaye royale de Saint Denis.
Les fouilles archéologiques montrent que
de nombreux chrétiens ont été inhumés sur la butte Montmartre. Leurs
ossements étaient rassemblés dans une carrière à mi-hauteur, c’est le
Martyrium ou champ des morts. Une chapelle fut érigée : ce Sanctum
Martyrium devint un lieu de pèlerinage fort célèbre.
Le sous-sol
La vie de Montmartre a été déterminée
par la richesse de son sous-sol qui est composé de quatre séries de
couches gypseuses, reposant sur une plate forme calcaire.
Les Romains extrayaient déjà le gypse.
Jusqu’au 17ème siècle, son utilisation pour construire les maisons a été
intensive, au point que le dicton en vogue était : « il y a plus de
Montmartre dans Paris que de Paris dans Montmartre ».
Les carrières étaient d’abord à ciel
ouvert, puis après interdiction du roi, l’extraction devint souterraine.
Les blocs de gypse étaient débités, cuits dans des fours. Le plâtre
ainsi obtenu était broyé, battu et mis en sac.
La montmartrite était réputée pour sa
résistance aux intempéries. La plupart des sarcophages mérovingiens ont
été fabriqués en plâtre moulé. Le métier de batteur de plâtre s’est
perpétué jusqu’au 19ème siècle.

- Sarigue de Montmartre
- Marsupial provenant du gypse éocène de Montmartre.
L’exploitation intensive du sous sol de
Montmartre a bouleversé la circulation des eaux souterraines, sources
taries, cavités creusées, ce qui a provoqué des effondrements de
terrains .
L’exploitation des carrières a cessé
vers la fin du 19ème siècle, et depuis 1980, le service des Carrières
mène une campagne d’injection de béton pour consolider les zones
fragilisées.
Des ossements fossilisés furent
découverts par Cuvier en 1798 aux abords d’une des anciennes entrées des
carrières de Montmartre. Ces restes ont démontré que la Butte fut
habitée par des animaux d’espèces disparues. On a retrouvé aussi dans
une couche de marnes calcaires, un tronc de palmier d’un volume
considérable, pétrifié en silex.
Histoire de la Sorbonne
L’Université naît au XIIIème siècle de l’organisation en corporation des maîtres et écoliers de Paris. Primitivement installés dans l’Île de la Cité, ces derniers sont venus, dès le XIIème siècle, dans le futur « quartier Latin », rive gauche de la Seine, où la théologie, le droit, la médecine et les arts sont enseignés, en plein air, à des jeunes gens venant des 4 Nations (Française, Picarde, Normande et Anglaise), conférant ainsi à l’Université, dès l’origine, un prestige international.
Le collège de Robert de Sorbon, fondé en 1253, est alors un des nombreux collèges hébergeant sur le flanc de la montagne Sainte-Geneviève des étudiants pauvres.
Très vite, ces collèges deviennent le cadre des disciplines universitaires de Paris, et le Collège de Sorbon une célèbre Faculté de Théologie « LA SORBONNE » qui prendra une part active aux débats Philosophiques et Politiques de son temps, oscillant au grès d’une histoire foisonnante entre un conservatisme jaloux et un libéralisme éclairé.
Au XVIIème siècle, la Sorbonne est reconstruite par l’architecte Jacques Lemercier à la demande du Cardinal Duc de Richelieu, qui en devient le proviseur en 1622.
Fermée par la révolution en 1791, puis devenue atelier d’artistes en 1801, la Sorbonne est, sous la Restauration, à nouveau réaffectée à l’enseignement par le Roi Louis XVIII qui y fait aussi installer l’Académie de Paris et l’Ecole des Chartes en 1821.
A la fin de XIXe siècle, la troisième République la reconstruira à son tour pour faire de la Nouvelle Sorbonne le sanctuaire de l’Esprit, le lieu privilégié de la Connaissance.
video de la -sorbonne
video histoire de la Sorbonne
Le
Panthéon
Louis XV
décide rebâtir l'église de l'abbaye Sainte-Geneviève en 1744 au sommet de
la Montagne Sainte-Geneviève.
Jacques
Germain Soufflot est désigné comme architecte pour réalisé le Panthéon, Le roi pose de la première pierre
en 1764.
Le Panthéon est construit
en forme de croix grecque de 110 m de long, 80 m de largeur et 83 m de haut.
|
|
|
| vers la place du Panthéon |
 |
 |
| vers l'intérieur | la coupole |
 |
|
 |
| vers le Panthéon en 1900 | sculptures du fronton |
le lanternon
|
Le non de Soufflot a été
donné à la rue qui relie le boulevard
St Michel et le
jardin du Luxembourg
au Panthéon, derrière celui-ci se trouvant L'église
St Etienne du Mont et
le lycée
Henri IV.
Louis
XV décide de reconstruire l'église Sainte-Geneviève qui, en ruines, est accolée
à la belle église Saint-Etienne du Mont.
La
première pierre est posée le 6 septembre 1764.
Grand
admirateur de l'architecture gréco-romaine, Soufflot imagine un gigantesque édifice,
bâti sur un plan de croix grecque
Suit
au décès de Soufflot en 1780 son élève Rondelet, élève achève les travaux
en 1789.
Le
style architectural de l'édifice est emprunté à l'art antique que l'on redécouvre
à cette époque, à l'occasion de fouilles comme celles d'Herculanum et de Pompéi
en Italie.
L'architecte
déclaré vouloir" réunir la légèreté de l'architecture gothique avec
la magnificence de l'architecture grecque ".
En
avril 1791, la Constituante ordonne la fermeture de l'église et charge Antoine
Quatremère de Quincy de modifier la structure de l'édifice, à peine achevé,
pour en faire un temple destiné à recevoir" les cendres des grands hommes
de l'époque de la liberté française" .
En
1806, les églises de France, fermées sous la Révolution, sont rendues au
culte. Le Panthéon retrouve ainsi sa fonction et son appellation d'origine: église
Sainte-Geneviève.
Dans
la période qui suit, le Panthéon est alternativement laïc (sous la monarchie
de Juillet, en 1830), puis religieux en 1851 (sous la présidence de Louis-Napoléon
Bonaparte).
En
1871, le monument sert de quartier général aux insurgés de la Commune
En
1885 sous la IIIe République, l'édifice est définitivement transformé en
monument républicain , lors des funérailles de
Victor
Hugo.
L'inscription
en lettres d'or" Aux grands hommes la Patrie reconnaissante" date de
1837.
Des
sculptures de marbre figurant le Baptême de Clovis, Attila et Sainte-Geneviève
encadrent la porte centrale. Puvis
de Chavanne, notamment, a réalisé au Panthéon ses plus belles fresques
parmi lesquelles : La
jeunesse de Sainte Geneviève et Sainte Geneviève de Paris.
La
crypte s'étend sous toute la surface du Panthéon. Elle
est constituée de plusieurs galeries séparées les unes des autres par des
piliers doriques.
Devant
l'entrée, une urne renferme depuis 1920 le cœur de Gambetta. Le tombeau de Jean
Jacques Rousseau fait face à celui de
Voltaire.
Dans
les galeries suivantes, se trouvent les tombes de Jean Moulin,
Victor
Hugo, Emile
Zola, Louis Braille (inventeur de
l'écriture pour les aveugles) , Victor Schoelcher (à qui on
doit l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848) , René
Cassin, auteur de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, Jean
Monnet, l'un des pères
de l'Europe.
La
dernière galerie contient les tombes des 41 dignitaires du premier Empire: généraux,
hommes d'Etat, cardinaux, savants (comme le grand mathématicien Lagrange) et
explorateurs (tel Bougainville).
Lorsqu'en
1964, les cendres de Jean Moulin y sont transférées, André Malraux
fait un discours dans lequel il rappelle la barbarie de la Seconde Guerre
mondiale.
En
1995, la première femme, Marie Curie, pénètre dans l'enceinte des grands
hommes.
Le
Panthéon
Toute l'histoire du Panthéon de
Paris
ARC DE TRIOMPHE
Place de l'Étoile - Place Charles de Gaulle
Histoire des Halles : le ventre de Paris
Bien que des milliers de personnes
transitent chaque jours aux Halles de Paris, très peu en connaissent
l’histoire. Se sera chose faite
L’Histoire des Halles est bien plus ancienne qu’on ne le pense puisque ses origines remontent au 12e
siècle (1137), lorsque Louis VI met en place un premier marché à cet
emplacement, sur d’anciens marécages. Ce marché va très rapidement
prendre de l’ampleur et c’est Philippe Auguste qui y ajoutera les
premières halles, en bois, quelques années plus tard (1183).
Du 13e au 18e siècle (du règne de
Saint-Louis à celui de Louis XVI), les Halles abritent aussi un pilori,
au niveau de l’actuel croisement de la rue Rambuteau et de la rue
Mondétour (la rue Pirouette n’existe plus). Les condamnés, en majorité
des commerçants véreux, utilisant de faux poids, des proxénètes et des
blasphémateurs y étaient exposés 2h par jour pendant 3 marchés de suite
et les passants pouvaient leur jeter toutes sortes d’ordures. Le
bourreau avait son logement au rez-de-chaussée.

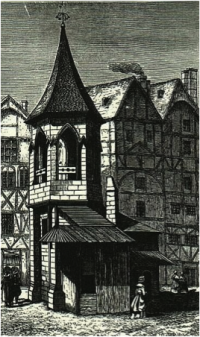

Le marché des Halles continuant de
s’étendre au fil des siècles, un immense projet est confié à
l’architecte Victor Baltard en 1852 (sous le Second Empire), qui
construit dix pavillons en métal et en verre, chacun ayant sa spécialité
(viande, légumes…). A l’époque, ces constructions sont une véritable
révolution architecturale. Le projet de Baltard inclut la Halle au blé,
construite au 18e siècle (1763), qui est toujours visible aujourd’hui, et qui abrite la Bourse de Commerce.


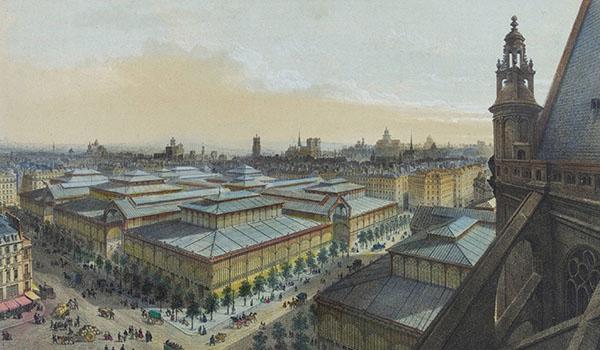





Parcours Chefs-d'œuvre du musée
Durée : 1h30
00Introduction
Souvent, la première visite au Louvre consiste à découvrir les
trois grandes dames du musée : La Vénus de Milo, la Victoire de
Samothrace et La Joconde. Ce premier parcours accessible permet de voir
ou de revoir ces chefs-d’œuvre, et d’autres encore, et de s’interroger
sur cette notion, si difficile à définir.
Lorsque le musée ouvre ses portes en 1793 à partir des collections des rois de France, le but avoué est d'offrir de grands modèles à l'éducation des artistes à venir, afin que renaisse "le grand style" des temps passés. Si aujourd'hui on croise toujours étudiants et copistes dans les salles, la pratique du musée a bien changé. Ce sont près de six millions de visiteurs, de tous pays et de toutes cultures, qui se pressent chaque année au Louvre et il y a bien des manières de le visiter. Cependant, il y a un empressement, quasi universel, autour de quelques "chefs-d'œuvre" , semblant toucher l'âme du spectateur, quelle que soit sa nationalité ou sa culture.
Au IVe siècle av. J.-C., le philosophe grec Platon écrivit qu'aucun artiste ne peut atteindre le Beau idéal. De tout temps, les artistes se sont confrontés à cette question de la Beauté suprême, intemporelle, proposant des solutions qui reflétaient leur époque et leur génie particulier, et il semble que certaines de ces réponses trouvent en nous un écho, encore aujourd'hui.
Mais, avec le XIXe siècle, l'œuvre d'art acquiert de nouvelles fonctions et le chef-d'œuvre n'est plus forcément synonyme de Beau, d'abstraction esthétique visant à la délectation. Certaines oeuvres résonnent de cette nouvelle tonalité, annonçant sur bien des points le statut des oeuvres contemporaines dans notre société.
Loin d'être chronologique ce parcours propose des coups de projecteurs sur des œuvres devant lesquelles on s'arrête spontanément.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Depuis la pyramide, dirigez-vous vers Sully, contournez les escalators et prenez à droite les ascenseurs D ou E vers mezzanine, accès aux collections. Entrez dans l'aile Sully et dirigez-vous vers le Louvre médiéval : à l'entrée de celui-ci, tournez à gauche et prenez l'ascenseur G pour vous rendre au 1er étage. Tournez à droite en sortant de l'ascenseur et traversez le palier pour entrer dans la salle des Bronzes. Continuez tout droit : vous entrez dans la salle 74. Tournez à droite, l’ascenseur C se trouve sur votre droite en sortant de la salle. Prenez l’ascenseur direction Rez-de-chaussée vers les Antiquités grecques. La première œuvre du parcours, La Vénus de Milo, se trouve immédiatement sur votre gauche dans la salle 7.
Lorsque le musée ouvre ses portes en 1793 à partir des collections des rois de France, le but avoué est d'offrir de grands modèles à l'éducation des artistes à venir, afin que renaisse "le grand style" des temps passés. Si aujourd'hui on croise toujours étudiants et copistes dans les salles, la pratique du musée a bien changé. Ce sont près de six millions de visiteurs, de tous pays et de toutes cultures, qui se pressent chaque année au Louvre et il y a bien des manières de le visiter. Cependant, il y a un empressement, quasi universel, autour de quelques "chefs-d'œuvre" , semblant toucher l'âme du spectateur, quelle que soit sa nationalité ou sa culture.
Au IVe siècle av. J.-C., le philosophe grec Platon écrivit qu'aucun artiste ne peut atteindre le Beau idéal. De tout temps, les artistes se sont confrontés à cette question de la Beauté suprême, intemporelle, proposant des solutions qui reflétaient leur époque et leur génie particulier, et il semble que certaines de ces réponses trouvent en nous un écho, encore aujourd'hui.
Mais, avec le XIXe siècle, l'œuvre d'art acquiert de nouvelles fonctions et le chef-d'œuvre n'est plus forcément synonyme de Beau, d'abstraction esthétique visant à la délectation. Certaines oeuvres résonnent de cette nouvelle tonalité, annonçant sur bien des points le statut des oeuvres contemporaines dans notre société.
Loin d'être chronologique ce parcours propose des coups de projecteurs sur des œuvres devant lesquelles on s'arrête spontanément.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Depuis la pyramide, dirigez-vous vers Sully, contournez les escalators et prenez à droite les ascenseurs D ou E vers mezzanine, accès aux collections. Entrez dans l'aile Sully et dirigez-vous vers le Louvre médiéval : à l'entrée de celui-ci, tournez à gauche et prenez l'ascenseur G pour vous rendre au 1er étage. Tournez à droite en sortant de l'ascenseur et traversez le palier pour entrer dans la salle des Bronzes. Continuez tout droit : vous entrez dans la salle 74. Tournez à droite, l’ascenseur C se trouve sur votre droite en sortant de la salle. Prenez l’ascenseur direction Rez-de-chaussée vers les Antiquités grecques. La première œuvre du parcours, La Vénus de Milo, se trouve immédiatement sur votre gauche dans la salle 7.

© 2010 Musée du Louvre / Anne Chauvet
01Aphrodite, dite "Vénus de Milo"
Il n'y a rien de plus frustrant que d'étudier l'art grec ! En effet,
les originaux sont trop peu nombreux et ne se présentent jamais dans
leur état originel. Imagineriez-vous cette statue avec des bras, mais
aussi des bijoux et de la couleur ?
La Vénus de Milo, ou l'Aphrodite de Mélos (du nom de l'île où on l'exhuma en 1820), est l'un de ces derniers grands originaux. La nudité de son buste permit de reconnaître Aphrodite, la Vénus des Romains, déesse de l'amour et de la beauté, née de la mer.
Certains détails stylistiques ont permis de la dater aux alentours de 100 av. J.-C. L'élongation de la silhouette et sa position dans la troisième dimension, la nudité, très charnelle, rattachent cette oeuvre à l'époque hellénistique (323-31 av. J.-C.), la dernière grande période de l'histoire grecque.
Cependant, le visage neutre et impassible tranche comme un masque rapporté. Hors du temps et des émotions, il est composé par un jeu de proportions : il mesure trois fois la hauteur du nez qui prolonge le front en ce "profil grec " que, bien sûr, les Grecs n'avaient pas réellement ! C'est la beauté des dieux, celle des Idées de Platon, que l'on cherche à figurer et non pas la réalité du monde. Cette image"qui dit la beauté dans une langue qui est toujours la nôtre" (Alain Pasquier) est une belle réponse à cette quête éternelle de la Beauté, un chef-d'oeuvre intemporel en somme.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Reprenez l'ascenseur C jusqu'au 1er étage. Tournez à gauche, puis à nouveau à gauche dans la rotonde, pour rejoindre la Galerie d'Apollon. Admirez les trésors de la Galerie. Pour vous rendre à la peinture italienne, rejoignez le fond de la salle : une porte mène au salon carré. Les personnes à mobilité reduite peuvent demander à un agent de la surveillance de leur ouvrir la porte pour accéder au Salon Carré. Rejoignez la Grande Galerie. Au niveau de la statue de Diane chasseresse, tournez à droite : La Joconde se présente face à vous.
La Vénus de Milo, ou l'Aphrodite de Mélos (du nom de l'île où on l'exhuma en 1820), est l'un de ces derniers grands originaux. La nudité de son buste permit de reconnaître Aphrodite, la Vénus des Romains, déesse de l'amour et de la beauté, née de la mer.
Certains détails stylistiques ont permis de la dater aux alentours de 100 av. J.-C. L'élongation de la silhouette et sa position dans la troisième dimension, la nudité, très charnelle, rattachent cette oeuvre à l'époque hellénistique (323-31 av. J.-C.), la dernière grande période de l'histoire grecque.
Cependant, le visage neutre et impassible tranche comme un masque rapporté. Hors du temps et des émotions, il est composé par un jeu de proportions : il mesure trois fois la hauteur du nez qui prolonge le front en ce "profil grec " que, bien sûr, les Grecs n'avaient pas réellement ! C'est la beauté des dieux, celle des Idées de Platon, que l'on cherche à figurer et non pas la réalité du monde. Cette image"qui dit la beauté dans une langue qui est toujours la nôtre" (Alain Pasquier) est une belle réponse à cette quête éternelle de la Beauté, un chef-d'oeuvre intemporel en somme.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Reprenez l'ascenseur C jusqu'au 1er étage. Tournez à gauche, puis à nouveau à gauche dans la rotonde, pour rejoindre la Galerie d'Apollon. Admirez les trésors de la Galerie. Pour vous rendre à la peinture italienne, rejoignez le fond de la salle : une porte mène au salon carré. Les personnes à mobilité reduite peuvent demander à un agent de la surveillance de leur ouvrir la porte pour accéder au Salon Carré. Rejoignez la Grande Galerie. Au niveau de la statue de Diane chasseresse, tournez à droite : La Joconde se présente face à vous.

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado
02Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo
Acquise par François Ier en 1518 et célébrée par les artistes de son temps, ce n'est qu'au XXe siècle que La Joconde acquiert sa notoriété, plus par ses "aventures" , notamment son vol en 1911, que par ses qualités pourtant remarquables.
La technique picturale éblouissante, presque magique, de Léonard modèle les formes par des glacis (couches de couleur très diluées, presque transparentes), jouant avec l'ombre et la lumière en estompant les contours (le sfumato). La perspective aérienne, passant du brun au bleu, compose, par la densité de l'air, un paysage abstrait de terre et d'eau. Il est dommage que le vieillissement du vernis obscurcisse les coloris : les manches étaient jaune safran !
L'identité du modèle fait l'objet d'hypothèses parfois farfelues, jusqu'à en faire un homme ! Il s'agit probablement du portrait, commencé à Florence entre 1503 et 1507, de Monna ("Madame") Lisa Gherardini del Giocondo. Le sourire serait ainsi l'emblème de son nom - gioconda signifiant aussi "heureuse".
Si une seule planche de peuplier très mince (12 mm) fait d'elle l'un des plus grands portraits du temps, ce n'est pourtant pas l'image ostentatoire d'une riche bourgeoise, bien que sa pose, sa toilette ou l'absence de cils et de sourcils conviennent à l'élégance de son rang. C'est surtout un portrait idéal, reflet des recherches platoniciennes du temps qui voient dans la beauté du corps celle de l'âme.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Retournez-vous et admirez Les Noces de Cana du peintre Véronèse.
La technique picturale éblouissante, presque magique, de Léonard modèle les formes par des glacis (couches de couleur très diluées, presque transparentes), jouant avec l'ombre et la lumière en estompant les contours (le sfumato). La perspective aérienne, passant du brun au bleu, compose, par la densité de l'air, un paysage abstrait de terre et d'eau. Il est dommage que le vieillissement du vernis obscurcisse les coloris : les manches étaient jaune safran !
L'identité du modèle fait l'objet d'hypothèses parfois farfelues, jusqu'à en faire un homme ! Il s'agit probablement du portrait, commencé à Florence entre 1503 et 1507, de Monna ("Madame") Lisa Gherardini del Giocondo. Le sourire serait ainsi l'emblème de son nom - gioconda signifiant aussi "heureuse".
Si une seule planche de peuplier très mince (12 mm) fait d'elle l'un des plus grands portraits du temps, ce n'est pourtant pas l'image ostentatoire d'une riche bourgeoise, bien que sa pose, sa toilette ou l'absence de cils et de sourcils conviennent à l'élégance de son rang. C'est surtout un portrait idéal, reflet des recherches platoniciennes du temps qui voient dans la beauté du corps celle de l'âme.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Retournez-vous et admirez Les Noces de Cana du peintre Véronèse.

© 2010 Musée du Louvre / Angèle Dequier
03Les Noces de Cana
Cette immense toile ornait le réfectoire du monastère de San Giorgio
Maggiore à Venise. Véronèse, admirable coloriste et célèbre pour son
talent à brosser d'immenses scènes aux multiples personnages, choisit
ici le premier miracle du Christ, lors des Noces de Cana. Travaillant la
perspective de manière à impliquer le spectateur dans la scène, il
transpose l'épisode biblique dans la riche Venise de son époque, le XVIe
siècle. Notez la splendeur des tissus, la richesse des bijoux, des
plats d'argent et de vermeil et l'architecture élégante inspirée de
Palladio qui offre une scène majestueuse à cet épisode sensé se passer
chez de pauvres gens qui viennent à manquer de vin lors d'un banquet de
noces. À la droite du Christ trônant au centre, Marie constate ce manque
en tenant un verre invisible dans sa main. À droite au premier plan, un
personnage en jaune verse une jarre d'eau changée en vin, miracle
constaté par les deux personnages derrière lui. Un homme vêtu de vert se
précipite vers les mariés, à gauche devant les colonnes, en demandant
pourquoi le meilleur vin a été réservé pour la fin du banquet.
Une autre lecture de l'oeuvre se fait verticalement par l'image symbolique des bouchers découpant la viande, du sablier sur la table des musiciens et du chien rongeant un os : l'annonce du "sacrifice de l'agneau ", la mort du Christ qui révéla par ce miracle sa vraie nature. Mais ces chiens sont aussi allégorie de fidélité, celle des chrétiens dont la foi balayera les nuages.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Revenez vers La Joconde et dirigez-vous vers le fond de la salle en passant à la droite de La Joconde ; vous pouvez admirer des œuvres du Titien et de Tintoret. Continuez tout droit : vous entrez dans la salle 74 consacrée à la peinture française. Dirigez-vous vers la salle rouge qui est sur votre droite, admirez la célèbre oeuvre de David, Le Sacre de l'empereur Napoléon,sur votre gauche.
Une autre lecture de l'oeuvre se fait verticalement par l'image symbolique des bouchers découpant la viande, du sablier sur la table des musiciens et du chien rongeant un os : l'annonce du "sacrifice de l'agneau ", la mort du Christ qui révéla par ce miracle sa vraie nature. Mais ces chiens sont aussi allégorie de fidélité, celle des chrétiens dont la foi balayera les nuages.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Revenez vers La Joconde et dirigez-vous vers le fond de la salle en passant à la droite de La Joconde ; vous pouvez admirer des œuvres du Titien et de Tintoret. Continuez tout droit : vous entrez dans la salle 74 consacrée à la peinture française. Dirigez-vous vers la salle rouge qui est sur votre droite, admirez la célèbre oeuvre de David, Le Sacre de l'empereur Napoléon,sur votre gauche.

© Musée du Louvre, dist. RMN / Angèle Dequier
04Sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement del'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris,le 2 décembre 1804
Trois ans furent nécessaires à David pour venir à bout de cette oeuvre
colossale commandée par Napoléon Ier pour immortaliser son couronnement
le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. Redécoré pour l'occasion dans
le style néoclassique par une architecture de bois peint en
trompe-l'oeil, le choeur de la cathédrale représente le plateau d'un
théâtre où chaque acteur prend place dans une mise en scène grandiose.
Comme toute oeuvre de propagande politique, certains arrangements avec la vérité y sont notables : la présence de la mère de l'empereur, au centre sur un trône, pourtant absente ce jour-là car fâchée avec son fils ; ou la beauté idéale d'un Napoléon grandi et aminci et d'une Joséphine rajeunie par le pinceau d'un artiste diplomate dont l'empereur fit son Premier Peintre. On préféra aussi au moment où l'empereur se couronna seul, le geste moins provocant du couronnement de Joséphine que le pape Pie VII, assis derrière Napoléon, bénit sans grande conviction.
Un éclairage savant met en relief ces figures parmi les cent cinquante portraits des figurants et s'attarde sur le brillant d'un bijou, l'onctuosité d'un tissu ou la douceur du velours d'un coussin. David se fait le précurseur de ces photographes actuels qui immortalisent les fastes des grands, dans ces journaux où le luxe se doit de faire rêver le public. Cependant, le plus vivant de ces personnages est sans doute Talleyrand, vêtu de rouge, à droite, qui semble poser un regard ironique sur cet étalage ostentatoire.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Sur le mur qui fait face au Sacre se trouve un des premiers chefs-d'oeuvre de David, Le Serment des Horaces. Avant de vous diriger vers cette oeuvre, admirez La Victoire de Samothrace qui déploie ses ailes face à vous.
Comme toute oeuvre de propagande politique, certains arrangements avec la vérité y sont notables : la présence de la mère de l'empereur, au centre sur un trône, pourtant absente ce jour-là car fâchée avec son fils ; ou la beauté idéale d'un Napoléon grandi et aminci et d'une Joséphine rajeunie par le pinceau d'un artiste diplomate dont l'empereur fit son Premier Peintre. On préféra aussi au moment où l'empereur se couronna seul, le geste moins provocant du couronnement de Joséphine que le pape Pie VII, assis derrière Napoléon, bénit sans grande conviction.
Un éclairage savant met en relief ces figures parmi les cent cinquante portraits des figurants et s'attarde sur le brillant d'un bijou, l'onctuosité d'un tissu ou la douceur du velours d'un coussin. David se fait le précurseur de ces photographes actuels qui immortalisent les fastes des grands, dans ces journaux où le luxe se doit de faire rêver le public. Cependant, le plus vivant de ces personnages est sans doute Talleyrand, vêtu de rouge, à droite, qui semble poser un regard ironique sur cet étalage ostentatoire.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Sur le mur qui fait face au Sacre se trouve un des premiers chefs-d'oeuvre de David, Le Serment des Horaces. Avant de vous diriger vers cette oeuvre, admirez La Victoire de Samothrace qui déploie ses ailes face à vous.

© 2014 Musée du Louvre / Philippe Fuzeau
05Victoire de Samothrace
Original grec sans doute détruit par un tremblement de terre, cette
statue fut retrouvée en d'innombrables morceaux en 1863 dans l'île de
Samothrace, au nord-est de la mer Égée. L'aile droite est une copie en
plâtre de l'aile gauche, seule conservée. Le socle de ciment sous ses
pieds est également moderne ; elle devait se poser directement sur le
pont du bateau. En haut d'une colline, elle se présentait de manière
oblique dans un édicule, ce qui explique pourquoi son côté droit fut
moins soigneusement travaillé.
La Victoire, "Niké" en grec, est saisie dans l'instant où elle se pose sur le pont du navire auquel elle apporte la faveur des dieux. Sa main droite, retrouvée en 1950, permet de restituer le geste d'origine : la main levée, elle annonce l'événement.
Dans une mise en scène spectaculaire bien dans le goût de l'époque hellénistique, elle était visible de loin par les navires s'approchant de l'île. Les proportions, le rendu des formes du corps, la manière dont la draperie claquant au vent est traitée et l'ampleur du mouvement très théâtral sont autant de témoignages des recherches réalistes de ce temps.
Des chercheurs ont pensé que ce monument serait un ex-voto offert par des Rhodiens pour remercier les dieux après une victoire navale, vers 190 av. J.-C.
Malraux se félicita des mutilations accidentelles de cette statue, qui en font une icône intemporelle de l'art occidental, "un chef-d'oeuvre du destin".
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Après ce détour par la sculpture grecque, admirez Le Serment des Horaces de David sur votre gauche.
La Victoire, "Niké" en grec, est saisie dans l'instant où elle se pose sur le pont du navire auquel elle apporte la faveur des dieux. Sa main droite, retrouvée en 1950, permet de restituer le geste d'origine : la main levée, elle annonce l'événement.
Dans une mise en scène spectaculaire bien dans le goût de l'époque hellénistique, elle était visible de loin par les navires s'approchant de l'île. Les proportions, le rendu des formes du corps, la manière dont la draperie claquant au vent est traitée et l'ampleur du mouvement très théâtral sont autant de témoignages des recherches réalistes de ce temps.
Des chercheurs ont pensé que ce monument serait un ex-voto offert par des Rhodiens pour remercier les dieux après une victoire navale, vers 190 av. J.-C.
Malraux se félicita des mutilations accidentelles de cette statue, qui en font une icône intemporelle de l'art occidental, "un chef-d'oeuvre du destin".
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Après ce détour par la sculpture grecque, admirez Le Serment des Horaces de David sur votre gauche.

© 2009 Musée du Louvre / Erich Lessing
06Le Serment des Horaces
Invariablement ces oeuvres nous remémorent des souvenirs de livres
scolaires. La Révolution y était évoquée par ces toiles où s'illustrent
les grands sentiments et l'héroïsme grandiose. Mais, en fait, c'est
Louis XVI qui motiva la naissance de ce style en réaction à l'esprit
féminin et léger de l'époque précédente où la mythologie était plus
prétexte à la nudité féminine qu'à l'édification du spectateur. Les
révolutionnaires, prônant le sacrifice ultime à la patrie,
rechercheront, dans ce retour à l'Antique, des épisodes marquants de
l'histoire romaine pouvant servir leur idéologie. Le peintre
Jacques-Louis David sera le chef de file de ce mouvement :néoclassique"
et signe là le chef-d'oeuvre du genre.
Des trois fils Horaces jurant à leur père fidélité à Rome, un seul reviendra vainqueur des duels contre les Curiaces de la cité d'Albe : il tuera sa propre soeur, Camille, car elle pleure la mort de son fiancé, un Curiace !
La mise en scène d'une grande sobriété, éclairée comme au théâtre, se situe dans le décor austère d'une maison républicaine. Les lignes droites, les couleurs chaudes et fortes des personnages masculins contrastent avec les lignes souples et les couleurs plus claires du groupe des femmes à l'accablement résigné. La perfection illusionniste de la technique, où toute trace du pinceau serait "vulgaire" , répond au souci de David de "peindre comme on parlait à Sparte". Cela donne l'impression, presque dérangeante, d'un instantané pris il y a plus de 2000 ans.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Revenez vers l'entrée de la salle. Sur le mur entre les deux portes, La Grande Odalisque de Jean-Auguste Dominique Ingres se dévoile face à vous.
Des trois fils Horaces jurant à leur père fidélité à Rome, un seul reviendra vainqueur des duels contre les Curiaces de la cité d'Albe : il tuera sa propre soeur, Camille, car elle pleure la mort de son fiancé, un Curiace !
La mise en scène d'une grande sobriété, éclairée comme au théâtre, se situe dans le décor austère d'une maison républicaine. Les lignes droites, les couleurs chaudes et fortes des personnages masculins contrastent avec les lignes souples et les couleurs plus claires du groupe des femmes à l'accablement résigné. La perfection illusionniste de la technique, où toute trace du pinceau serait "vulgaire" , répond au souci de David de "peindre comme on parlait à Sparte". Cela donne l'impression, presque dérangeante, d'un instantané pris il y a plus de 2000 ans.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Revenez vers l'entrée de la salle. Sur le mur entre les deux portes, La Grande Odalisque de Jean-Auguste Dominique Ingres se dévoile face à vous.

© 2005 Musée du Louvre / Angèle Dequier
07Une Odalisque
Ingres transpose ici le thème antique du nu féminin dans un Orient vers
lequel il n'a voyagé qu'en rêve et qui est prétexte à l'image sensuelle
d'une femme de harem - titre de l'oeuvre - nue et offerte dans un décor
exotique. Jusqu'à la fin de sa vie, Ingres reprendra des thèmes
orientalistes et le nu féminin, l'un de ses sujets favoris - comme dans Le Bain turc -, en mêlant à sa peinture des influences diverses qui vont de Raphaël et des artistes maniéristes aux miniatures persanes.
Si, comme son maître David, Ingres est un artiste classique, par sa technique ou son intérêt pour l'Antique qu'il montre dans d'autres oeuvres, il se détache de ce courant en privilégiant la ligne du dessin, des courbes sensuelles, déformant au besoin la réalité anatomique des corps. Cette odalisque possède trois vertèbres de trop ! De même, le sein droit et la jambe gauche se rattachent étrangement au reste du corps. Contrastant avec cette déformation physique, la lourde draperie bleue, le turban ou le narguilé sont traités d'une manière illusionniste. Les critiques de l'époque, totalement désarçonnés par cette fusion chimérique, mépriseront son style si singulier. En revanche, Ingres aura une formidable influence sur les artistes modernes dont Picasso qui reprendra avec bonheur son inventivité et sa manière de recomposer les corps à sa façon.
Au reste, l'harmonie bleue et or, plutôt froide, ne détache-t-elle pas définitivement cette image de la réalité pour en faire un pur fantasme d'artiste ?
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Sortez de la salle 75 et dirigez vous tout droit vers la salle 77 des peintres romantiques. Admirez sur votre gauche le célèbre Radeau de la Méduse du peintre Théodore Géricault.
Si, comme son maître David, Ingres est un artiste classique, par sa technique ou son intérêt pour l'Antique qu'il montre dans d'autres oeuvres, il se détache de ce courant en privilégiant la ligne du dessin, des courbes sensuelles, déformant au besoin la réalité anatomique des corps. Cette odalisque possède trois vertèbres de trop ! De même, le sein droit et la jambe gauche se rattachent étrangement au reste du corps. Contrastant avec cette déformation physique, la lourde draperie bleue, le turban ou le narguilé sont traités d'une manière illusionniste. Les critiques de l'époque, totalement désarçonnés par cette fusion chimérique, mépriseront son style si singulier. En revanche, Ingres aura une formidable influence sur les artistes modernes dont Picasso qui reprendra avec bonheur son inventivité et sa manière de recomposer les corps à sa façon.
Au reste, l'harmonie bleue et or, plutôt froide, ne détache-t-elle pas définitivement cette image de la réalité pour en faire un pur fantasme d'artiste ?
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Sortez de la salle 75 et dirigez vous tout droit vers la salle 77 des peintres romantiques. Admirez sur votre gauche le célèbre Radeau de la Méduse du peintre Théodore Géricault.

© 2010 Musée du Louvre / Angèle Dequier
08Le Radeau de la Méduse
Manifeste du Romantisme, ce tableau causa un énorme scandale au Salon
de 1819. Pour la première fois, un artiste représente sans commande un
événement de l'histoire contemporaine et met en scène des anonymes, dans
le format de la peinture d'histoire.
Précurseur de l'esprit critique qui anime bien souvent l'art aujourd'hui, le sujet constitue une critique acerbe du gouvernement en place : le naufrage, en 1816, de La Méduse résultait de l'incompétence d'un capitaine revenu à son poste par faveur politique. Manquant de canots de sauvetage, cent quarante-neuf personnes se tassèrent sur un radeau qui dériva durant douze jours et seuls quinze survécurent, rescapés des massacres, de la folie et du cannibalisme !
Le radeau, vu d'un angle, paraît très instable et deux diagonales condensent le drame : l'une conduit le regard vers une énorme vague risquant d'engloutir le radeau, l'autre vers la minuscule silhouette de L'Argus, qui leur portera secours. Cette grande oblique évoque la tragédie - le torse d'un homme peut-être dévoré par ses compagnons - et tous les états psychologiques : l'abattement de l'homme désorienté tenant son fils mort, le sursaut de l'agonisant se redressant et l'espoir acharné de ceux faisant signe au sauveteur éventuel. Mais, dans ce moment choisi, nul ne sait de quel côté penchera cette terrible balance.
L'humanité est ici le seul héros de cette émouvante histoire et c'est ce qui nous touche encore aujourd'hui.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Revenez dans la salle 74, prenez les ascenseurs K ou L, direction Rez-de-chaussée, pour vous rendre à la dernière étape du parcours. En sortant des ascenseurs, dirigez-vous sur la droite pour emprunter l'ascenseur M direction Rez-de-chaussée sculpture Italienne. Admirez Les Esclaves de Michel Ange qui se présentent face à vous dans le fond de la Galerie.
Précurseur de l'esprit critique qui anime bien souvent l'art aujourd'hui, le sujet constitue une critique acerbe du gouvernement en place : le naufrage, en 1816, de La Méduse résultait de l'incompétence d'un capitaine revenu à son poste par faveur politique. Manquant de canots de sauvetage, cent quarante-neuf personnes se tassèrent sur un radeau qui dériva durant douze jours et seuls quinze survécurent, rescapés des massacres, de la folie et du cannibalisme !
Le radeau, vu d'un angle, paraît très instable et deux diagonales condensent le drame : l'une conduit le regard vers une énorme vague risquant d'engloutir le radeau, l'autre vers la minuscule silhouette de L'Argus, qui leur portera secours. Cette grande oblique évoque la tragédie - le torse d'un homme peut-être dévoré par ses compagnons - et tous les états psychologiques : l'abattement de l'homme désorienté tenant son fils mort, le sursaut de l'agonisant se redressant et l'espoir acharné de ceux faisant signe au sauveteur éventuel. Mais, dans ce moment choisi, nul ne sait de quel côté penchera cette terrible balance.
L'humanité est ici le seul héros de cette émouvante histoire et c'est ce qui nous touche encore aujourd'hui.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Revenez dans la salle 74, prenez les ascenseurs K ou L, direction Rez-de-chaussée, pour vous rendre à la dernière étape du parcours. En sortant des ascenseurs, dirigez-vous sur la droite pour emprunter l'ascenseur M direction Rez-de-chaussée sculpture Italienne. Admirez Les Esclaves de Michel Ange qui se présentent face à vous dans le fond de la Galerie.

© 2010 Musée du Louvre / Raphaël Chipault
09Captif
Les oeuvres de Michel-Ange conservées en dehors de l'Italie sont
rarissimes mais le Louvre possède ces deux statues magistrales offertes
au roi de France par le florentin Roberto Strozzi qui les reçut de
l'artiste en personne. Elles appartiennent à un ensemble - d'autres
statues sont conservées au musée de l'Académie à Florence - destiné à
orner le tombeau du pape Jules II, un projet gigantesque à l'origine
mais plusieurs fois modifié puis finalement très réduit. Symboles des
passions vaincues, de l'âme enchaînée au corps ou des nations soumises à
l'autorité du Pape, les lectures possibles sont multiples. Il pourrait
également s'agir des arts prisonniers après la mort d'un grand mécène
(Jules II avait financé la décoration de la chapelle Sixtine) car, aux
pieds de l'esclave mourant, ou plutôt endormi, se trouve un singe,
allégorie de la peinture copiant la réalité à la manière d'un singe
imitant l'homme.
Ces oeuvres sont inachevées comme le prouvent les très nombreuses traces d'outils. Contrairement aux autres sculpteurs, Michel-Ange progressait généralement dans le bloc sans modèle, de la face vers le dos. Notez la main de l'esclave rebelle encore prisonnière du marbre. Seul un formidable artiste travaillant directement la roche peut se permettre une telle audace. Fier de son travail et le montrant, c'est un artiste de la Renaissance, qui revendique ici la liberté du créateur choisissant jusqu'au moment où arrêter son ciseau.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Ainsi se termine ce premier parcours accessible. Pour rejoindre la sortie, reprenez l’ascenseur M direction Entresol et sortez de l’aile Denon. Suivez ensuite la mezzanine pour emprunter les ascenseurs D ou E qui vous mèneront à la Pyramide. Prenez l'ascenseur tubulaire pour rejoindre la sortie.
Auteur(s) :
Sandrine Bernardeau, conférencière RMN, DP
Ces oeuvres sont inachevées comme le prouvent les très nombreuses traces d'outils. Contrairement aux autres sculpteurs, Michel-Ange progressait généralement dans le bloc sans modèle, de la face vers le dos. Notez la main de l'esclave rebelle encore prisonnière du marbre. Seul un formidable artiste travaillant directement la roche peut se permettre une telle audace. Fier de son travail et le montrant, c'est un artiste de la Renaissance, qui revendique ici la liberté du créateur choisissant jusqu'au moment où arrêter son ciseau.
Itinéraire jusqu'à la prochaine œuvre :
Ainsi se termine ce premier parcours accessible. Pour rejoindre la sortie, reprenez l’ascenseur M direction Entresol et sortez de l’aile Denon. Suivez ensuite la mezzanine pour emprunter les ascenseurs D ou E qui vous mèneront à la Pyramide. Prenez l'ascenseur tubulaire pour rejoindre la sortie.
Auteur(s) :
Sandrine Bernardeau, conférencière RMN, DP
De la place de la Concorde au palais du Louvre
© 2000 Musée du Louvre / Etienne Revault
1La Place de la Concorde (XVIIIe - XIXe siècle)
La plus grande place de Paris (259 mètres de côté), conçue en 1754 par l’architecte de Louis XV, Jacques-Ange Gabriel, s'appelait alors la Place Louis XV.
En 1793, la Place Louis XV devient la Place de la Révolution et installe en son centre la guillotine qui exécuta en particulier Louis XVI et Marie-Antoinette. En 1830, à l'issue de la Révolution de juillet, la place reçoit son nom définitif « La Concorde ». La Place conserve aujourd'hui l'aspect général qu'elle avait au dix-huitième siècle.
L'Obélisque de Louxor offert par le vice-roi d'Egypte, Mohamed Ali au roi Louis Philippe est installé en 1836. De granit rose, haut de 23 mètres, lourd de 230 tonnes, vieux de 33 siècles, il marquait auparavant l'entrée du temple d'Amon à Louxor. Son sommet est surmonté d'un pyramidion de bronze et de feuilles d'or ajouté en mai 1998.
Il est entouré de deux hautes fontaines dédiées à la navigation maritime et fluviale et bordé de statues qui représentent de grandes villes françaises : Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Brest et Rouen.
Cette place se situe sur le grand axe qui traverse Paris depuis l'ouest avec La Défense, l'Arc de triomphe, les Champs-Elysées, le jardin des Tuileries, le Louvre.
2Le jardin des Tuileries : un jardin à la française (1645-1700)
À l'entrée du Jardin des Tuileries, se trouve la statue d'André Le Nôtre, paysagiste français, jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 1700 qui a conçu l'aménagement du parc du palais de Versailles, de Vaux-le-Vicomte, de Chantilly…, et de nombreux autres jardins.
Les caractéristiques de ses travaux sont le schéma géométrique, les vastes perspectives, l'usage des plans et des jeux d'eaux, de statues qui créent un cadre imposant et font la célébrité du jardin "à la française".
Le Jardin à la Française, prolongement du château répond à l'architecture. Rien n'est laissé au hasard. Tout est fait pour que le visiteur ait une vision d'ensemble de l'agencement global du jardin.
Le plan d'ensemble est géométrique et la symétrie est poussée à l'extrême :
- division en espaces découverts (allée, pelouse, bosquet) et espaces couverts (plantés d'arbres)
- ordre le long d'un axe de symétrie qui traverse le jardin
- lignes droites des allées parallèles ou transversales qui se coupent.
- illusions perspectives : André Le Nôtre étudia avec minutie la peinture et les effets d'optiques afin de créer des jeux de perspective. Par exemple, il a décalé les petits bassins ronds des Jardins Réservés, situés à gauche et à droite du Bassin Rond (côté place du Carrousel), afin qu’ils paraissent plus vaste que le Bassin Octogonal alors qu'il est deux fois plus petit.
La statue équestre de Louis XIV du Bernin

© RMN (Musée du Louvre) / Hervé Lewandowski
Cour Napoléon : Statue
équestre de Louis XIV de Gian Lorenzo Bernini dit le Bernin, moulage en
plomb effectué en 1988 d'un marbre du Bernin modifié en statue de Marcus
Curtius par François Girardon, en 1687
Le Bernin, architecte et aussi sculpteur, réalise une statue équestre du roi dont une copie en plomb orne la cour Napoléon. L'original en bronze se trouve au château de Versailles. C'est Ieoh Ming Pei, l'architecte de la pyramide qui a eu l'idée de commander cette copie en 1986 et de la placer dans l'axe des Champs-Elysées. Depuis l'arc du Carrousel, cet axe emprunte de manière rectiligne l'avenue des Champs-Élysées, la place Charles-de-Gaulle, l'avenue de la Grande-Armée, la Porte Maillot pour se prolonger à l'extérieur de Paris et traverser le quartier de la Défense.
Outre la statue équestre de Louis XIV, cet axe est ponctué par de nombreux monuments comme l'arc de triomphe du Carrousel, le jardin des Tuileries, l'Obélisque de la place de la Concorde, l'Arc de triomphe de l'Étoile ou l'Arche de la Défense. Par contre, la Pyramide du Louvre n'est pas située sur cet axe, la cour Napoléon n'étant pas alignée sur l'axe historique.
Les croquis du monarque avaient été réalisés par l'artiste Le Bernin, lors de son séjour en France mais la sculpture une fois réalisée ne répondait plus à l'attente de Louis XIV. Le sculpteur François Girardon fut chargé de transformer la statue. Il ajouta un casque au cavalier et des flammes à la place du rocher initial. La statue de Louis XIV devint alors une statue du général romain Marcus Curtius se jetant dans les flammes pour sauver Rome incendiée.
Le Bernin, architecte et aussi sculpteur, réalise une statue équestre du roi dont une copie en plomb orne la cour Napoléon. L'original en bronze se trouve au château de Versailles. C'est Ieoh Ming Pei, l'architecte de la pyramide qui a eu l'idée de commander cette copie en 1986 et de la placer dans l'axe des Champs-Elysées. Depuis l'arc du Carrousel, cet axe emprunte de manière rectiligne l'avenue des Champs-Élysées, la place Charles-de-Gaulle, l'avenue de la Grande-Armée, la Porte Maillot pour se prolonger à l'extérieur de Paris et traverser le quartier de la Défense.
Outre la statue équestre de Louis XIV, cet axe est ponctué par de nombreux monuments comme l'arc de triomphe du Carrousel, le jardin des Tuileries, l'Obélisque de la place de la Concorde, l'Arc de triomphe de l'Étoile ou l'Arche de la Défense. Par contre, la Pyramide du Louvre n'est pas située sur cet axe, la cour Napoléon n'étant pas alignée sur l'axe historique.
Les croquis du monarque avaient été réalisés par l'artiste Le Bernin, lors de son séjour en France mais la sculpture une fois réalisée ne répondait plus à l'attente de Louis XIV. Le sculpteur François Girardon fut chargé de transformer la statue. Il ajouta un casque au cavalier et des flammes à la place du rocher initial. La statue de Louis XIV devint alors une statue du général romain Marcus Curtius se jetant dans les flammes pour sauver Rome incendiée.
L’arc du Carrousel

© 2010 Musée du Louvre / Pierre Philibert
En 1806, le sommet de l'arc du Carrousel comportait initialement quatre sculptures de chevaux que Napoléon avait pris à la cathédrale Saint-Marc de Venise et qui seront rendus en 1815. Il comportait deux allégories, la Victoire et la Paix, et un char sur lequel devait se trouver une statue de l'empereur. Celui-ci ayant refusé d’être représenté, le char est resté vide. L'arc du Carrousel réutilise un vocabulaire décoratif antique : des colonnes corinthiennes de marbre blanc et rouge, des bas-reliefs retraçant les épisodes majeurs de la campagne, le quadrige (char de quatre chevaux) à son sommet. Ce style qui s'inspire de l'Antiquité est appelé « néoclassicisme ».
Le Louvre médiéval

© 2007 Musée du Louvre / Angèle Dequier
Le roi Philippe Auguste en 1190 ordonne la construction d'un mur d'enceinte qui protège Paris d'une éventuelle invasion des anglais qui sont basés en Normandie. Le château fort du Louvre, sur la rive droite de la Seine surveille l'accès à la ville. Le donjon entouré d'un fossé et de solides murailles, domine toute la ville et constitue le symbole du pouvoir monarchique.
Le roi Saint Louis fait aménager une grande salle et une salle basse en 1226 (dite salle Saint Louis visible encore aujourd’hui). En1285, Philippe Le Bel y place son arsenal, les archives et le trésor royal qui restera dans le donjon pendant quatre siècles. Le Louvre perd sa fonction défensive et est transformé par Charles V en 1364 en un château de plaisance. Le maitre d'œuvre, Raymond du Temple, perce des fenêtres, orne la façade de statues, élève les toitures, des tourelles et installe des cheminées. Charles V, qui est un roi lettré, installe sa bibliothèque de 973 livres, qui est la plus riche du royaume et fait planter un jardin d'agrément ainsi qu'un jardin potager au nord.
Le Louvre au XXe siècle : la Pyramide

© 2007 Musée du Louvre / Angèle Dequier
En 1981, le président de la République, François Mitterrand décide de transformer le Louvre afin d'agrandir le musée.Le projet d'aménagement de la cour est confiée à l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei.
Le ministère des Finances (installé au Louvre depuis un siècle) doit quitter l'aile Richelieu afin de laisser la place aux collections du musée. Le public, toujours plus nombreux, doit pouvoir circuler sans difficulté. L'entrée principale sera placée au centre du Louvre, dans la cour Napoléon, par commodité et par souci de clarté de l'orientation. Comment construire un tel aménagement ?
Trois solutions sont envisagées : construire à la manière des constructions environnantes en imitant les différents styles déjà présents ; construire en sous-sol et ne rien laisser visible en surface ; construire un bâtiment qui donne espace et lumière au nouveau hall d'accueil du musée. Cette dernière solution sera retenue et Ieoh Ming Pei proposera une pyramide, forme qui s'intègre parfaitement dans l'espace avec un volume moins imposant qu'une forme cubique ou rectangulaire.
La pyramide a les mêmes proportions que la pyramide de Gizeh. Chaque face de la pyramide est constituée de 128 poutres en acier inox, croisées, parallèles aux arêtes de la pyramide.
Le vitrage est constitué de 675 losanges de 2,9 m x 1,9 m. Ils sont constitués par deux couches de verre "extra blanc" de 10 mm d'épaisseur. Tour de force technologique, la fabrication de ce verre totalement incolore a nécessité la construction d'un four spécial fonctionnant à l'électricité pour diminuer les oxydes de fer. Grâce à cette transparence absolue, les pierres du palais environnant, vues de l'intérieur de la pyramide, gardent leur couleur miel.
La Pyramide est inaugurée le 30 mars 1989. Son coût est de 75 millions de francs (11.43 millions d'euros), la toiture la plus chère du monde. Le nettoyage assuré par des guides de haute montagne est maintenant assuré par un robot. La pyramide attire du monde : le Louvre est passé de trois millions de visiteurs annuels avant l’aménagement à 8,5 millions en 2008.
La légende du fantôme des Tuileries
L’histoire du palais des Tuileries est liée à une légende, celle du petit homme rouge des Tuileries.
Nous sommes en 1564, Catherine de
Médicis, Reine de France, se lance dans un projet pharaonique:
transformer les fabriques de tuiles du bord de la Seine en demeure
royale.
Après la construction de son palais,
celle-ci vint y vivre ; mais aussitôt, elle prit ce séjour en horreur et
le quitta pour toujours.
Elle déclara qu’un fantôme,
aux apparitions prophétiques, rodait dans le palais et qu’il lui avait
prédit qu’elle mourrait près de Saint-Germain. le spectre diabolique des
tuileries portait comme uniforme … un costume rouge couleur sang !
Cette légende du fantôme des Tuileries
vient en réalité de Jean dit l’Ecorcheur, un boucher désosseur, qui
vécut au temps de Catherine de Médicis et qui travaillait dans
l’abattoir à proximité du palais. Celui-ci aurait été égorgé par un
certain Neuville, sur demande de Catherine de Médicis au motif qu’il
connaissait plusieurs secrets de la couronne. Au moment de mourir, il
aurait promis à Neuville qu’il reviendrait d’entre les morts. Il ne
tarda pas à tenir sa promesse … alors que Neuville s’en retournait pour
rendre compte de l’accomplissement de sa mission à la Reine, il sentit
derrière lui comme une présence. Il se retourna et découvrit, avec
horreur, Jean qui se tenait là, debout, baignant dans son sang.
Le fantôme aurait prévenu l’astrologue
de Catherine de Médicis du danger imminent qui la guettait : « La
construction des Tuileries la mènera à sa perte, elle va mourir ». Le
petit homme rouge hanta les nuits de la Reine jusqu’à sa mort, le 5
janvier 1589 à Blois.
A partir de cet instant et au fil des siècles, le fantôme des Tuileries devint la terreur du palais des Tuileries en annonçant toujours un drame à celui à qui il apparaissait.
Ainsi, en juillet 1792, il apparaît à la Reine Marie-Antoinette,
peu de temps avant la chute de la Monarchie. La légende dit que
Marie-Antoinette aurait même demandé au Comte de Saint-Germain, magicien
de l’époque, de la protéger du fantôme des Tuileries. Les formules
magiques n’y feront rien, le fantôme l’accompagnera jusqu’à sa
condamnation à mort en 1793.
Plus tard, en 1815, c’est à Napoléon Ier qu’il
apparaît, quelques semaines avant la bataille de Waterloo. Enfin, il
apparut en 1824 à Louis XVIII et à son frère le comte d’Artois, quelques
jours avant la mort du premier. Les prophéties du petit homme rouge
étaient implacables.
Le dernier chapitre de cette légende se
passe le 23 mai 1871… en plein insurrection des communards à Paris. Le
Palais des Tuileries fut alors incendié pendant trois jours
consécutifs. Le feu détruisit la totalité du bâtiment. La silhouette du
petit homme rouge fut observée par plusieurs témoins avant de
disparaître à jamais dans les flammes.
Pour en savoir plus sur cette légende et bien d’autres, participez à notre visite guidée des légendes de Paris ! Inscriptions ici !

La
Conciergerie
La plus ancienne prison de Paris résonne encore
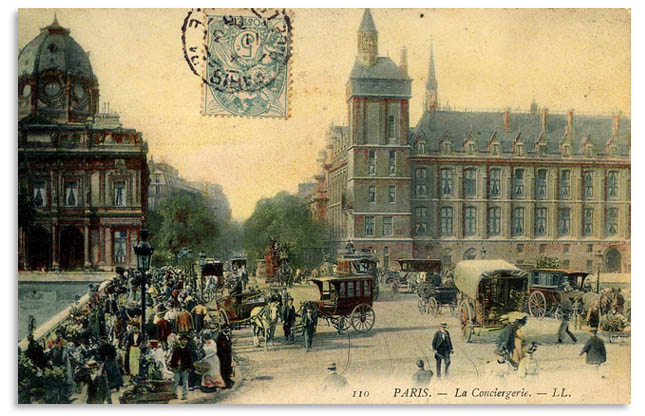 des sanglots de Maie-Antoinette, Reine de France
et femme de Louis XVI, attendant dans son cachot l'heure fatale de sa
décapitation durant cinq semaines. Non loin de la
Sainte-Chapelle, la Conciergerie fascine les visiteurs à cause
de ce souvenir sombre de la Révolution française. A cette
époque, plus de 4000 prisonniers furent mis à l'abri
derrière les murs froids et épais de cette prison-tribunal,
en attendant leur funeste rendez-vous avec la guillotine. Robespierre
et Danton eux-mêmes, grands ordonnateurs de peines capitales,
furent mis aux fers dans les lieux. La cellule de la reine
déchue demeure, de loin, l'attraction la plus prisée des
touristes. Pourtant, un autre détenu célèbre fut
emprisonné et torturé dans cette bâtisse :
Ravaillac, l'assassin du bon roi Henri IV. Autre curiosité de la
Conciergerie, la salle gothique des Gens d'Armes abritait les soldats
de la garde du roi. Remarquablement bien préservée,
elle évoque parfaitement la vie de caserne à
l'époque de sa construction par Phlippe le Bon au XIVème
siècle Ne pas oublier de visiter la salle de tortures
logée dans la Tour Bonbec pour éprouver un frisson. A
l'extérieur de la Conciergerie, sur le mur du Palais de Justice,
angle du quai de l'Horloge, se trouve encore la première horloge
publique parisienne, fabriquée en 1370 et en parfait état
de marche.
des sanglots de Maie-Antoinette, Reine de France
et femme de Louis XVI, attendant dans son cachot l'heure fatale de sa
décapitation durant cinq semaines. Non loin de la
Sainte-Chapelle, la Conciergerie fascine les visiteurs à cause
de ce souvenir sombre de la Révolution française. A cette
époque, plus de 4000 prisonniers furent mis à l'abri
derrière les murs froids et épais de cette prison-tribunal,
en attendant leur funeste rendez-vous avec la guillotine. Robespierre
et Danton eux-mêmes, grands ordonnateurs de peines capitales,
furent mis aux fers dans les lieux. La cellule de la reine
déchue demeure, de loin, l'attraction la plus prisée des
touristes. Pourtant, un autre détenu célèbre fut
emprisonné et torturé dans cette bâtisse :
Ravaillac, l'assassin du bon roi Henri IV. Autre curiosité de la
Conciergerie, la salle gothique des Gens d'Armes abritait les soldats
de la garde du roi. Remarquablement bien préservée,
elle évoque parfaitement la vie de caserne à
l'époque de sa construction par Phlippe le Bon au XIVème
siècle Ne pas oublier de visiter la salle de tortures
logée dans la Tour Bonbec pour éprouver un frisson. A
l'extérieur de la Conciergerie, sur le mur du Palais de Justice,
angle du quai de l'Horloge, se trouve encore la première horloge
publique parisienne, fabriquée en 1370 et en parfait état
de marche. LA SAINTE CHAPELLE
LA CATHÉDRALE DE NOTRE DAME
Au cœur de l’Île de la Cité

Détail du "plan de Paris" de Melchior Tavernier vers 1630
L’Île de la Cité est le centre de l’antique Lutèce comme celui du Paris medieval et contemporain.
L’Île de la Cité est formée par les méandres de la Seine. Habitée par les Gaulois Parisis dès le deuxième siècle avant J-C et occupée par les Romains
de Jules César en 52 avant J-C, elle s’étend sur sept hectares, au
carrefour de la navigation sur la Seine et de la grande voie romaine
appelée le cardo (actuellement dans l’axe de la rue Saint Martin et de la rue Saint Jacques).
Cette voie enjambait le fleuve, à l’époque romaine, à l’aide de deux ponts de bois sur pilotis : le Grand Pont (actuel Pont Notre-Dame) et le Petit Pont.

- Le pilier des Nautes
Berceau de la Lutèce gauloise, l’Île de la Cité contrôle à l’époque romaine le commerce fluvial qui, au Ier siècle de notre ère, a fait la prospérité des nautes parisiens, en témoigne le Pilier des Nautes* aux effigies gauloises et Romaines conservé au Musée de Cluny.
Dans la partie en aval, à la pointe ouest, l’Île fut fortifiée à la fin du IIIe siècle après J-C. Elle devint alors résidence impériale et administrative. Julien, dit l’Apostat, y fut proclamé empereur par ses soldats en 359-360. Valentinien Ier, autre empereur romain, s’y installa durant l’hiver 365-366. En 508, Clovis, roi des Francs, y fixe le siège de son royaume. Ce lieu restera résidence royale jusqu’à la construction du Louvre sous le règne de Philippe Auguste au XIIe siècle. Toujours à cet emplacement, Saint Louis fera construire entre 1242 et 1248 la sainte chapelle, écrin de la sainte couronne d’épines.De nos jours se dresse sur ces emplacements le Palais de Justice
de la Ville de Paris. Dans ce dernier sont conservés quelques vestiges
de l’ancien palais royal : les Tours Barbec, d’Argent, de César, de
l’Horloge, les Salles des Gardes et de la Conciergerie.

- Les tours du Palais de Justice de Paris
- © Michel Setboun
Dans la partie en amont, à la pointe Est, le christianisme, né vers le IIIe siècle à Paris sous l’impulsion de l’évêque Saint Denis, s’affirme au cours des IVe, Ve et VIe siècles. Dans cette capitale qui prend le nom du peuple qui l’habite - Paris -, une ville sainte se construit comprenant une Eglise-Cathédrale , un baptistère, un évêché, le cloître des habitations canoniales avec des écoles épiscopales, ainsi qu’un Hôtel-Dieu* pour les malades et les déshérités sur les bords de la Seine.
Au IXe siècle de petites églises
sont construites sur le parvis pour accueillir les reliques menacées
par les pillards normands. Vers 1100, on peut estimer la population de
l’île de la Cité à 3000 habitants, y compris les clercs, les écolâtres
et les serviteurs du Palais Royal.
Au XIIe siècle, Maurice de Sully, alors évêque de Paris, entreprend la construction d’une nouvelle cathédrale sur le site des deux lieux de culte antérieurs : Notre-Dame et Saint Etienne. On perce alors la Rue Neuve
dans l’axe de la future cathédrale au milieu d’un dédale de ruelles, de
maisons à pans de bois enserrées, ainsi que de dix-sept chapelles. La
percée permet l’acheminement des matériaux de construction et relier la cathédrale à la voie nord-sud existante.

- Procession du 15 août sur l’’Île de la Cité
- © Godong
Dans sa configuration actuelle, le parvis Notre-Dame, élargi au XVIIe
siècle, a été libéré de toute habitation par le baron Haussmann – dans
les années 1860-1870, tout fut rasé. Sur le pavé s’inscrit le tracé des
édifices disparus (dont la cathédrale Saint-Etienne). La crypte archéologique fait état des vestiges découverts par les fouilles de 1965-1967.
CENTRE POMPIDOU
CENTRE POMPIDOU
| |||||||||||||
"Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel qui soit à la fois un musée et un centre de création". Par ces mots prononcés en 1969, le Président de la République ouvrira la voie à un grand concours international pour la construction du centre qui portera son nom. Une consultation internationale sera lancée à la fin de l'année 1970. Plus de 650 projets seront examinés. Le projet de Renzo Piano et de Richard Rogers sortira vainqueur de cette compétition en 1971. Il se présente sous la forme d'un gigantesque parallélépipède de 166 mètres de longueur, de 60 mètres de largeur et de 42 mètres de hauteur. Très novateur dans sa conception il est orné de cheminées de paquebot et de tubulures métalliques peintes de couleurs vives. Les riverains et passants sont stupéfaits. La presse s'empare du sujet et alimente la polémique. Lorsque le Centre ouvre enfin ses portes, le 31 décembre 1977, de nombreux visiteurs s'étonnent de la présence d'échafaudages. L'événement architectural suscite des réactions dans le monde entier. De nombreuses voix s'élève contre la présence, au coeur du Paris historique, d'un "tas de tubes", de plastique, de charpente et de verre. Les architectes ont résolument privilégié l'espace intérieur. Chaque niveau de l'édifice comporte un plateau de 7500 mètres carrés. Les escaliers, ascenseurs, escalators et l'ensemble des conduits d'aération et d'alimentation ont été repoussés à l'extérieur, en façade. La couleur des poutrelles et des gaines correspond à leur fonction : bleu pour l'air conditionné, vert pour les fluides, rouge pour les transports et jaune pour l'électricité. Face à la piazza, un grand escalier mécanique circule en diagonale, dans un tube de verre entouré par des arceaux. Des travaux de restauration du Centre Beaubourg, destinés à réparer les outrages du temps et à remettre à niveau l'ensemble des installations éprouvées par une fréquentation très supérieure aux prévisions initiales, ont été entrepris en 1997. Ils ont entraîné une fermeture du Centre qui a rouvert ses portes à la fin de l'année 2000. | |||||||||||||
VUES PANORAMIQUES DE LA TERRASE


Description
Le Centre Pompidou accueille, chaque année, près de 25 expositions temporaires qui font événement avec la mise en lumière des figures magistrales et mouvements fondateurs de l’histoire de l’art du XXème siècle ainsi que les plus grands artistes de la scène contemporaine. Une riche programmation de cinéma, de théâtre, de danse, de concerts, de conférences et de colloques, des espaces pour le jeune public, une bibliothèque publique d’information, des boutiques et restaurants, complètent ce foisonnement artistique et font du Centre Pompidou un lieu pluridisciplinaire unique au monde.
VUES DE LA FAÇADE


Centre
Beaubourg-Georges
Pompidou,
 Amateur
d'art moderne, le président Georges Pompidou voulait construire un
grand musée d'art contemporain et une bibliothèque gratuite en libre
accès. Bien que désapprouvant le projet finalement retenu par le jury,
il n'a pas cherché à le mettre en cause. Les architectes ont voulu
construire un bâtiment familier comme une usine, ludique et intrigant,
"surtout pas un temple de la culture intimidant".
Amateur
d'art moderne, le président Georges Pompidou voulait construire un
grand musée d'art contemporain et une bibliothèque gratuite en libre
accès. Bien que désapprouvant le projet finalement retenu par le jury,
il n'a pas cherché à le mettre en cause. Les architectes ont voulu
construire un bâtiment familier comme une usine, ludique et intrigant,
"surtout pas un temple de la culture intimidant".
 Amateur
d'art moderne, le président Georges Pompidou voulait construire un
grand musée d'art contemporain et une bibliothèque gratuite en libre
accès. Bien que désapprouvant le projet finalement retenu par le jury,
il n'a pas cherché à le mettre en cause. Les architectes ont voulu
construire un bâtiment familier comme une usine, ludique et intrigant,
"surtout pas un temple de la culture intimidant".
Amateur
d'art moderne, le président Georges Pompidou voulait construire un
grand musée d'art contemporain et une bibliothèque gratuite en libre
accès. Bien que désapprouvant le projet finalement retenu par le jury,
il n'a pas cherché à le mettre en cause. Les architectes ont voulu
construire un bâtiment familier comme une usine, ludique et intrigant,
"surtout pas un temple de la culture intimidant".
La
contrainte majeure était de supprimer tous les obstacles intérieurs
pour permettre une complète liberté d'aménagement intérieur. Les
architectes ont utilisé la contrainte en "sortant et en exhibant
à l'extérieur les tripes du bâtiment" : les structures
métalliques, les gaines de circulation de couleur différente pour l'eau
(vert), le chauffage et
l'aération (bleu), l'électricité
(jaune), les circulations
(rouge) ; et surtout le grand escalier roulant dans son tube de verre.
Achevé en 1977, le centre Pompidou s'est bien intégré dans le vieux
Paris grâce à la fois à son respect de l'alignement
traditionnel et au contraste de ses formes et ses couleurs. C'est un
bâtiment certes moderne (beauté résidant dans les volumes et pas dans
la décoration, liberté des aménagements intérieurs) mais très
différent des immeubles en béton des décennies précédentes,
singulier dans tous les cas.
Attirant 25 000 personnes par jour, soit beaucoup plus que prévu, y compris une population marginale en hiver, le centre a été remis à neuf et réorganisé en 2000 : le musée d'art moderne a presque doublé en surface grâce au départ de l'administration de l'autre côté de la rue Rambuteau, la Bibliothèque publique d'information occupe désormais trois niveaux et bénéficie d'une entrée autonome sur la rue Beaubourg.
Il a repris les collections du musée d’art moderne créé en 1937 au palais de Tokyo. Enrichies d’autres donations et de nombreuses acquisitions, les collections ne pouvaient pas être présentées en permanence et le roulement sur les cimaises était important. Le musée expose ses toiles sur deux niveaux : art contemporain au 4è (figuration narrative des années 1960, peinture d'inspiration minimaliste, art conceptuel etc.), art moderne 'historique' (1905-1960) à l'étage du dessus (qu'on atteint par des escaliers -ou ascenseurs- intérieurs) : Fauves, cubistes, Bonnard, Matisse, Léger, Kandinski, Klee, Malévitch, Delaunay, peintures surréalistes, Dubuffet, groupe Cobra, Giacometti, etc.
Située à gauche des caisses (et nécessitant un billet pour les adultes accompagnateurs), la Galerie des enfants accueille trois fois par an une œuvre accessible et étonnante qui interpelle les jeunes et les moins jeunes. Voir aussi le site pour les juniors : www.
Attirant 25 000 personnes par jour, soit beaucoup plus que prévu, y compris une population marginale en hiver, le centre a été remis à neuf et réorganisé en 2000 : le musée d'art moderne a presque doublé en surface grâce au départ de l'administration de l'autre côté de la rue Rambuteau, la Bibliothèque publique d'information occupe désormais trois niveaux et bénéficie d'une entrée autonome sur la rue Beaubourg.
Il a repris les collections du musée d’art moderne créé en 1937 au palais de Tokyo. Enrichies d’autres donations et de nombreuses acquisitions, les collections ne pouvaient pas être présentées en permanence et le roulement sur les cimaises était important. Le musée expose ses toiles sur deux niveaux : art contemporain au 4è (figuration narrative des années 1960, peinture d'inspiration minimaliste, art conceptuel etc.), art moderne 'historique' (1905-1960) à l'étage du dessus (qu'on atteint par des escaliers -ou ascenseurs- intérieurs) : Fauves, cubistes, Bonnard, Matisse, Léger, Kandinski, Klee, Malévitch, Delaunay, peintures surréalistes, Dubuffet, groupe Cobra, Giacometti, etc.
Située à gauche des caisses (et nécessitant un billet pour les adultes accompagnateurs), la Galerie des enfants accueille trois fois par an une œuvre accessible et étonnante qui interpelle les jeunes et les moins jeunes. Voir aussi le site pour les juniors : www.
Vue
de Paris
Depuis la "chenille" et la terrasse du dernier étage, la vue sur le vieux Paris est fort intéressante, sans être circulaire. Un restaurant permet de se reposer. On ne peut plus y accéder sans prendre de billet.
Bibliothèque publique d'information (BPI) (www)
(tél. standart : 01 44 78 12 33, renseignement : 01 44 78 12 75, ouverte 12.00-22.00 sauf mardi, 11.00-22.00 le samedi-dimanche)
Ouverte en 1977 en même temps que le centre Pompidou, son principe était novateur : il s’agissait de permettre l’accès de la connaissance au plus grand nombre en organisant une bibliothèque ouverte à tous, gratuite et dont les livres sont en libre accès.
Depuis la "chenille" et la terrasse du dernier étage, la vue sur le vieux Paris est fort intéressante, sans être circulaire. Un restaurant permet de se reposer. On ne peut plus y accéder sans prendre de billet.
Bibliothèque publique d'information (BPI) (www)
(tél. standart : 01 44 78 12 33, renseignement : 01 44 78 12 75, ouverte 12.00-22.00 sauf mardi, 11.00-22.00 le samedi-dimanche)
Ouverte en 1977 en même temps que le centre Pompidou, son principe était novateur : il s’agissait de permettre l’accès de la connaissance au plus grand nombre en organisant une bibliothèque ouverte à tous, gratuite et dont les livres sont en libre accès.
place Stravinski
 L'"Institut
de recherches et coordination acoustique/musique" se distribue en
trois parties. Sous la place Stravinski s'étendent les studios et les
laboratoires de recherche et de création musicale (sur l'acoustique, la
perception). L'ancien immeuble en brique et en pierre accueille la
pédagogie et la documentation (médiathèque proposant des partitions,
des documents sonores). Enfin, l'extension moderne de Renzo Piano
réalisée en 1989 abrite les services généraux. Le bâtiment
s'intègre à ses voisins à la fois par l'utilisation de la brique et
par son alignement discret, mais il s'en distingue par ses formes
épurées.
L'"Institut
de recherches et coordination acoustique/musique" se distribue en
trois parties. Sous la place Stravinski s'étendent les studios et les
laboratoires de recherche et de création musicale (sur l'acoustique, la
perception). L'ancien immeuble en brique et en pierre accueille la
pédagogie et la documentation (médiathèque proposant des partitions,
des documents sonores). Enfin, l'extension moderne de Renzo Piano
réalisée en 1989 abrite les services généraux. Le bâtiment
s'intègre à ses voisins à la fois par l'utilisation de la brique et
par son alignement discret, mais il s'en distingue par ses formes
épurées.Aménagée en 1983, la fontaine contribue à l’animation « saltimbanque » suscitée par le centre Beaubourg. Sur la piazza officient les musiciens, les caricaturistes et les noueurs de tresses colorées. Devant la fontaine les musiciens, danseurs, mimeurs divertissent les passants. La fontaine a été aménagée par Jean Tinguely pour les mobiles en fer et Niki de Saint-Phalle pour les « nanas » et autres personnages colorés. Les sculptures rendent hommage au compositeur de Petrouchka et du sacre du Printemps (ci-dessus).
Construit en même temps que le quartier de Beaubourg, il a remplacé des petits immeubles et des ateliers de bonneterie et de mercerie, plus ou moins insalubres. Seules ont été conservées les façades de la rue Saint-Martin et quatre immeubles de la rue Beaubourg datant du début du siècle. Les immeubles nouveaux de 6 ou 7 étages s’intègrent dans la trame traditionnelle. Ils dominent les ruelles piétonnières d'un premier étage d'activités surmonté de volumes variés et de terrasses verdoyantes. Du côté de Beaubourg, le quartier s'ouvre par une statue de Zadkine représentant la fuite de Prométhée alors qu’il vient de ravir le feu du ciel. Au centre, la grande horloge figure le " Défenseur du temps " : toutes les heures, il combat l’un des trois monstres venus des airs, de la terre ou des mers. A midi et à 18h, il se bat contre tous les trois (Jacques Monestier, 1979).
L'ancien Hôtel de Ville de Paris
16
août
Année: 1852Photographe: Charles Marville
L’hôtel de ville de Paris héberge les institutions municipales depuis 1357. C’est en juillet 1357 qu’Etienne Marcel fit, au nom de la municipalité, l’acquisition de la « Maison aux Piliers ». Au XVIe siècle ce bâtiment fit place a un magnifique palais dessiné par l’architecte italien Boccador. Les travaux commencèrent en 1533 et s’achevèrent en 1628. Face au palais, la célèbre place de Grève fut souvent le rendez vous d’émeutiers, insurgés et révolutionnaires. D’Étienne Marcel à la Fronde, de la Révolution aux journées révolutionnaires de juillet 1830 et février 1848.
Sous le Second Empire (de 1852 à 1870) les travaux haussmanniens apportent une modernisation d’ensemble à la capitale française et c’est le début d’un Paris moderne fait de grands boulevards et de places dégagées.
C’est le 24 mai 1871, pendant la Commune de Paris, qu’un incendie réduisit le palais (ancien Hôtel de ville) en cendres.
Le bâtiment fut reconstruit entre 1874 et 1882 sur les plans des architectes Théodore Ballu et Édouard Deperthes qui conservèrent à la façade le style néo-renaissance de l’ancien palais.

L’Hôtel de Ville reconstruit quasiment à l’identique suite à l’incendie de la Commune/François Grunberg
La place de Grève, rebaptisée place de l’Hôtel-de-Ville le 19 mars 1803, est devenue un espace réservé aux piétons depuis 1982.
L’Hôtel de Ville actuel (plus grand bâtiment municipal en Europe), est un lieu de pouvoir où siège le conseil de Paris et de prestige où sont reçus les hôtes du maire. Deux espaces sont dédiés a de prestigieuses expositions. Jusqu’en 1977, l’actuel bureau du maire était celui occupé par le préfet de Paris. Le maire disposait à l’origine d’un appartement de fonction de 1 400 m2. C’est Bertrand Delanoë, le maire actuel, qui a décidé de le transformer en crèche.
PUZZLE DE L´HÔTEL DE VILLE
C'est le seul vestige de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie qui occupait l'emplacement de l'actuel square Saint-Jacques. Placé là dès l'époque carolingienne, le sanctuaire était à un carrefour important de voies menant au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. La statue du clocheton est celle du saint. Seule la tour gothique n'a pas été démolie pendant la Révolution française. Construite en 1523, elle témoigne de la persistance au 16è siècle des formes du Moyen Âge. C'est une station météorologique depuis 1891. Cachée pendant des années pour une restauration complète, la tour est enfin de nouveau visible (2008), toute immaculée.
A la base, la statue de Pascal rappelle que le philosophe renouvela ici en 1648 ses expériences barométriques du Puy-de-Dôme, comme l'indique son "Récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs". D'autres sources indiquent l'église St Jacques-du-Haut-Pas sur la montagne Ste Geneviève. Une stèle rend hommage à Gérard de Nerval qui fut trouvé pendu non loin de là en 1855.
C'est le seul vestige de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie qui occupait l'emplacement de l'actuel square Saint-Jacques. Placé là dès l'époque carolingienne, le sanctuaire était à un carrefour important de voies menant au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. La statue du clocheton est celle du saint. Seule la tour gothique n'a pas été démolie pendant la Révolution française. Construite en 1523, elle témoigne de la persistance au 16è siècle des formes du Moyen Âge. C'est une station météorologique depuis 1891. Cachée pendant des années pour une restauration complète, la tour est enfin de nouveau visible (2008), toute immaculée.
A la base, la statue de Pascal rappelle que le philosophe renouvela ici en 1648 ses expériences barométriques du Puy-de-Dôme, comme l'indique son "Récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs". D'autres sources indiquent l'église St Jacques-du-Haut-Pas sur la montagne Ste Geneviève. Une stèle rend hommage à Gérard de Nerval qui fut trouvé pendu non loin de là en 1855.
La
rue Saint-Martin qui passe devant
Beaubourg et la Tour Saint-Jacques est l'ancien cardo, la voie
principale nord-sud de Lutèce. Mais le quartier ne s'est urbanisé
qu'au 11è s avec la construction de la forteresse du Châtelet devant
le Pont Neuf (disparue en 1808).
Ponts de Paris
En 52 av. JC, la tribu des Parisii s’implante sur l’Ile de la Cité qui devient Lutèce. Deux ponts furent créés : le Petit Pont et le Grand Pont.
Pont Amont
Pont National
Pont de Tolbiac
Pont de Bercy
|
Passerelle Simone de Beauvoir
Viaduc d’Austerlitz
Pont de Sully
Pont de la Tournelle
|
Pont Notre-Dame
Pont Neuf
Passerelle des Arts
Pont Royal
|
Pont de la Concorde
|
Pont Alexandre III
|
Pont de Bir-Hakeim
|
Métro parisien
Si vous vous demandez pourquoi une station du métro parisien porte tel ou tel nom, quand et comment le métro a été crée, quelles sont les techniques employées : cette rubrique est faite pour vous.
Historique du métro
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
|
Ligne 3 bis
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6
|
Ligne 7
Ligne 7 bis
Ligne 8
Ligne 9
|
Ligne 10
Ligne 11
|
Ligne 12
Ligne 13
|
Ligne 14
|
La place Vendôme
Tout droit sortie de l’imagination du
roi soleil Louis XIV, la place Vendôme constitue le joyau de Paris en
même temps que le symbole de la monarchie absolue où se dérouleront à la
fois les foires du royaume ainsi que les mariages royaux. A l’époque où
Paris est avant tout constitué de rues étroites et de peu d’espaces
ouverts, au contraire la place Vendôme constitue un espace de liberté où
l’on peut respirer comme la place de Grève (actuelle place de l’hôtel
de ville) et la place royale (actuelle place des Vosges). Rapidement,
les plus grosses fortunes s’y installent et font sa renommée, mondiale.
L’oeuvre de Louis XIV
C’est le roi soleil qui est à l’origine
du projet. Il voulait quelque chose de grandiose et de magnifique.
Conseillé par l’architecte Jules Hardouin-Mansart et par Louvois le
superintendant des bâtiments Arts et Manufactures, le roi fait
l’acquisition de l’hôtel du duc de Vendôme en 1685. Le domaine couvre
huit hectares. Le projet initial préconise une architecture rigoureuse
pour les façades et l’implantation d’institutions royales comme la cour
des Monnaies, la bibliothèque ou encore les académies.
Mais le chantier n’aboutit pas et le Trésor a du déboursé quand même 2,3 millions de livres. Louis XIV
décide de céder gratuitement les terrains à la ville de Paris. Affaire
conclue le 7 avril 1699 mais le roi y met des conditions, réduire les
dimensions initiales de la place, et que les dessins des façades soient
conservés.
Rapidement, les plus grandes fortunes
s’y installent comme le banquier John Law l’inventeur du papier
monnaie, qui s’y installe en 1718. On y retrouve aujourd’hui les plus
luxueuses boutiques de Paris.
Lieu symbolique des évènements : révolution, coups d’Etat, retour au pouvoir des royalistes.
Les révolutionnaires ne s’y sont pas
trompés et prennent possession de ce haut lieu symbolique, pour
l’utiliser à leurs fins. Le 11 août 1792 Danton
investit la Chancellerie royale qui est sur la place depuis 1717 et y
installe le gouvernement provisoire de la république. La place n’a pas
échappé aux horreurs commises pendant la révolution et « la place des
piques » doit ce nom à une troupe de femmes qui a dépecé et promené
autour de la place, le corps de plusieurs royalistes.
L’une des premières décisions du gouvernement provisoire est de déboulonner la statue équestre du roi soleil le 13 août 1792.
En 1812, c’est là que le général Malet
tente un coup d’Etat après avoir annoncé la mort de l’empereur à Moscou.
Il est vite maîtrisé avec ses complices et exposé à la foule.
En 1816 la foule est venue assister à la
dégradation du général Bonnaire ancien soldat de l’empire condamné pour
la mort accidentelle du chef d’état major de louis XVIII.
Les royalistes ont choisi soigneusement le lieu de cette cérémonie, ce
sera au pied de la colonne Vendôme érigée en 1810 par Napoléon, en
hommage à la grande armée.
Cette colonne est faite de 1200 canons
pris en trophée dont on a coulé le bronze. Chaque régime politique en
fera un faire valoir.
La Restauration y plante son drapeau blanc après avoir ôté l’effigie de Napoléon.
La Monarchie de Juillet y plante son drapeau tricolore, avant d’y
remettre une statue de Napoléon, dans un souci de consensus politique.
Les troupes de Napoléon III convergent vers cette colonne lors de la
célébration des victoires de Magenta et de Solferino
Enfin, elle est restaurée et remise sur
son piédestal par la IIIème république. Elle trône toujours aujourd’hui
du haut de ses 44 mètres sur la célèbre place.
Les passions politiques ont désormais
déserté les lieux et laissé place aux boutiques de luxe. On y trouve
toujours la chancellerie.
|